DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, REPRESENTATIVE, DIRECTE : LA CRISE
Au sens chinois du terme…
Danger, Opportunité et Crise : des notions que connectent les idéogrammes chinois
危 机
Il est souvent évoqué le fait qu’en chinois, le mot « crise » est écrit par l’association de deux idéogrammes, l’un signifiant « danger » et l’autre, « opportunité. »
En réalité, ce n’est pas tout à fait exact.
La notion de « crise » correspond en effet, en chinois, à l’association de deux idéogrammes : mais c’est l’association de chacun des deux avec d’autres idéogrammes qui peut être traduite par « péril » ou par « opportunité. »
Le premier des deux idéogrammes du « mot » pouvant être traduit par « crise » symbolise une notion de danger, de caractère douteux : c’est l’idéogramme wei = 危 .
Il est impliqué dans des assemblages d’idéogrammes qui signifient : nuire ou compromettre ; critique au sens : sensible, déterminant ; ou encore : être sur le point de mourir.
Associé à l’idéogramme xian = 险, qui renvoie aux notions de difficulté ou d’échec – au sens où quelque chose n’est pas atteint, il donne le mot « péril. »
Le second symbolise une notion d’occasion, mais est impliqué dans de nombreux « mots » composés de plusieurs idéogrammes renvoyant à des objets, le plus souvent des moyens de transport.
C’est l’idéogramme ji = 机 .
La notion « d’occasion » qui lui est associée pourrait être évoquée par les idées de déplacement, ou de capacité à saisir.
Quant au « mot » pouvant être traduit par « opportunité », il correspond à la juxtaposition de cet idéogramme ji à un autre idéogramme, hui = 会< /span>, renvoyant à des notions de réunion, de savoir ou de pouvoir : des notions qui évoquent un phénomène d’extension, de plus grande étendue.
En somme, le concept de « crise » en chinois associe l’idée de quelque chose à craindre (un danger, un caractère douteux) avec celle de quelque chose à saisir (une occasion, le moyen de se déplacer).
Ce qui est donné à voir, par ce détour par la langue chinoise, est l’idée selon laquelle une crise n’est pas entièrement à craindre, surmonter ou traverser : une crise renferme aussi quelque chose à saisir ; elle porte en elle-même une occasion, un moyen.
|
|
机 |
会 |
Occasion, opportunité |
|
ji Machine, appareil, avion, occasion |
hui Réunion, pouvoir, savoir, comptable |
||
|
危 |
机 |
|
Crise |
|
wei Dangereux, douteux |
ji Machine, appareil, avion, occasion |
||
|
危 |
险 |
|
Dangereux, péril |
|
wei Dangereux, douteux |
xian Difficile à franchir, presque, faillir |
Quelques mots de mon parcours personnel :
Mon premier engagement politique date de 2002. Au lendemain du premier tour de la présidentielle ayant placé Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen en tête, j’ai adhéré au Parti socialiste. J’y ai contribué à la rédaction de l’une des Motions soumises au vote du Congrès appelé « de Dijon » (au passage, c’est François Mitterrand qui a voulu cette désignation des Congrès par le nom des villes où ils se tenaient, alors que Michel Rocard avait tenté de leur attribuer le numéro de l’ordre chronologique dans lequel ils se succédaient ; c’est intéressant, parce que le recours au nom de chacune des villes oblige à être très familier du fonctionnement et de l’évolution du PS : pour toute autre personne, c’est un facteur de confusion…).
J’ai démissionné du PS au lendemain de ce fameux Congrès de Dijon, qui avait consacré le choix de penser que l’échec de Lionel Jospin ne nécessitait pas une profonde remise en cause interne au PS et n’était dû, fondamentalement, qu’à des circonstances.
Mon deuxième engagement a consisté à prendre part à la campagne de François Bayrou lors de la présidentielle de 2007. Comme au sein du PS quelques années plus tôt, j’étais chargé des questions agricoles que je m’efforçais de hisser au rang de l’enjeu des accords internationaux (Pac et OMC). Ce fut une expérience assez extraordinaire.
Dans la foulée, je me suis présenté aux municipales de 2008 sur une liste Modem, au sein duquel je suis resté environ deux ans après la présidentielle. J’ai peu à peu cessé de m’y impliquer sans perdre contact avec plusieurs personnes de ce mouvement, pour lesquelles j’ai gardé une amitié sincère.
Mon troisième engagement a consisté à faire partie des fondateurs de Nouvelle Donne, en amont des européennes de 2014. J’ai contribué à la rédaction de la charte de ce mouvement qui se voulait défini par son fonctionnement et non par son contenu programmatique. Lorsque je me suis rendu compte de l’ambiguïté de cette formation, à laquelle adhéraient des personnes favorables à l’application du programme et aux idées du Collectif Roosevelt mais d’autres, pour sa charte et la promesse de fonctionnement qu’elle portait, j’ai choisi de démissionner.
Mon quatrième engagement est celui d’aujourd’hui, au sein de LaREM.
Le fil rouge de ces expériences a été celui de la maturation d’une conviction : celle de l’incurie des organisations politiques « traditionnelles. » Le positionnement de François Bayrou en 2007 préfigurait, par le jugement porté sur la représentation de la droite et de la gauche en France, ce qu’a été celui d’Emmanuel Macron lors des présidentielles de 2017. Et je crois que nous assistons (enfin, suis-je tenté d’ajouter) à un profond renouvellement du paysage politique.
Le socle des valeurs auxquelles je crois et qui sont au fondement de mon engagement aujourd’hui s’est consolidé au cours de toutes ces années. Je les décrirai ainsi :
-
Le respect de la personne : concrètement, c’est la conviction selon laquelle aucune personne ne peut être réduite à ce qu’elle dit, ni à ce qu’elle a fait. Une personne humaine est toujours plus que cela. Formulé ainsi, cela peut sembler peu de chose mais, en fait, c’est extrêmement exigeant…
-
Le respect de la contradiction : concrètement, c’est la conviction selon laquelle, pour départager deux points de vue, il faut toujours accorder autant de considération et d’importance à l’avis « conforme » qu’à l’avis « contraire », quel que soit le poids des effectifs qui se réclament de l’un ou de l’autre. C’est, également, très exigeant… et souvent contraire à ce qui ressemble au « bon sens. »
-
Le sens du compromis : c’est la conviction selon laquelle, en démocratie, aucun point de vue ne doit être imposé par le recours au rapport de forces. C’est préférer la force de conviction à celle de la persuasion, l’argumentation à l’intimidation, la recherche de l’adhésion de son interlocuteur à celle de son renoncement et ce, quel qu’il soit.
Au-delà, je suis un fervent partisan de la poursuite de la construction européenne et j’adhère à ce que l’on appelle couramment les valeurs « humanistes » : la valorisation de la connaissance et de la culture sous toutes ses formes, la foi dans le progrès des connaissances et des techniques, la recherche de l’épanouissement des individus par l’émancipation et l’autonomie…
J’ajoute une dernière précision sur mon parcours : mes expériences professionnelles m’ont conduit à travailler et à réfléchir dans le domaine de l’accompagnement personnel, le coaching d’organisations, les techniques qui s’y rapportent. J’ai appris – et j’y adhère – en quoi consistait la Communication non violente, j’ai pratiqué des exercices de conduite de réunions participatives (forums ouverts, world cafés…) et ce, en entreprise comme au sein d’organisations associatives.
Voilà donc, en quelque sorte, « d’où » je parle, d’où je viens en abordant le thème très vaste de la crise de la démocratie que nous traversons. Je ne prétends nullement épuiser le sujet, loin de là. Je prétends seulement contribuer à la réflexion qui peut permettre de saisir ce que cette crise offre d’opportunité, et de conjurer ce qu’elle porte de danger.
Crise de la représentativité : la confiscation par l’expertise
Depuis de nombreuses années, la place de l’expertise dans la décision publique et même, dans le fonctionnement des instances démocratiques, y compris du pouvoir judiciaire, est de plus en plus grande.
Le Conseil constitutionnel à propos de l’élimination des embryons surnuméraires
Un exemple illustre ce phénomène de façon très intéressante.
Le 29 juillet 1994, le Parlement a adopté une Loi de bioéthique, qui prévoyait notamment l’autorisation d’éliminer ce qu’on appelait « les embryons surnuméraires. » Il s’agissait de prendre acte d’une situation que personne n’avait anticipée et dont personne ne voulait prendre la responsabilité, jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la représentation nationale : la situation résultant du recours à une pratique de procréation médicalement assistée, celle des « bébés éprouvette. »
Cette pratique consiste à obtenir la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde « in vitro » : en milieu artificiel, dans une éprouvette de laboratoire. Or, pour garantir le résultat voulu, ce sont plusieurs ovules et plusieurs spermatozoïdes qui sont utilisés. Mais ce faisant, alors qu’un seul ovule fécondé est implanté dans l’utérus de la mère, il en existe d’autres qui sont laissés dans les éprouvettes.
Au fil des ans, le nombre de ces ovules fécondés qui étaient gardés par congélation a crû de façon considérable. Pour une raison simple : personne ne pouvait prendre la responsabilité de les éliminer… tout simplement parce que c’étaient, en quelque sorte, des « bébés en puissance. »
Et c’est ainsi qu’en 1994, le gouvernement a fini par demander à l’Assemblée nationale de bien vouloir autoriser l’Administration à éliminer ces embryons, qualifiés pudiquement de « surnuméraires. » Cette autorisation a été adoptée par un vote.
Mais aussitôt, des députés de la majorité ont saisi le Conseil constitutionnel. Il est à noter que c’est extrêmement rare : ce sont, d’habitude, des députés de l’opposition qui saisissent cette instance lorsqu’ils entendent vérifier que la Loi adoptée est bien constitutionnelle.
Les débats en séance publique font état de l’ampleur du problème moral, ou philosophique, de l’enjeu. La question, indécidable au sens où elle ne peut pas être tranchée par le recours au mécanisme de la preuve, est celle de savoir si un embryon est, ou n’est pas, une « personne humaine. » Plus exactement, la question est celle de savoir si le respect qui est dû, constitutionnellement, à toute personne humaine, est également dû à un embryon dont il est admis qu’il est une personne humaine « potentielle. »
Les approches des différentes religions et, notamment, des trois monothéismes, divergent sensiblement sur ce point.
Toujours est-il qu’un groupe de députés de la majorité a saisi le Conseil constitutionnel après l’adoption de la Loi par le Parlement.
Or, la réponse du Conseil constitutionnel, en l’occurrence, est particulièrement intéressante.
Lorsqu’il se dessaisit d’une question qui lui est posée en jugeant qu’elle ne relève pas de ses prérogatives, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il n’est pas censé se prononcer sur l’opportunité d’agir réservée au législateur, dont il n’examine que la constitutionnalité de ses dispositions, a priori. Et, ce faisant, le Conseil constitutionnel a recours à une formule consacrée, que l’on retrouve dans la plupart de ses rendus : il rappelle qu’il ne lui appartient pas « de juger des dispositions prises par le législateur » en ajoutant, toutefois : « sauf erreur manifeste. »
En d’autres termes, le Conseil constitutionnel se réserve le droit d’apprécier dans quelle mesure le législateur, « manifestement, » se trompe… c’est, d’une certaine manière, le « pouvoir d’interprétation du juge » qui est invoqué ici ; cette « intime conviction » qui peut orienter une décision de justice, en dépit d’un défaut de preuve.
Mais, s’agissant de la Loi de bioéthique de 1994, le Conseil constitutionnel a curieusement substitué une formule à celle qui évoque la possibilité d’une « erreur manifeste » du législateur : il s’est prononcé, après avoir rappelé le principe du respect de la personne humaine, en invoquant « l’état actuel des connaissances et des techniques… »
En d’autres termes, pour le dire schématiquement, le Conseil constitutionnel, saisi par des députés de la majorité pour établir la constitutionnalité de l’élimination des embryons surnuméraires, a considéré qu’il ne lui appartenait pas de sanctionner cette décision parce qu’il ne pouvait pas repérer une « erreur manifeste » et que seul « l’état des connaissances et des techniques » lui aurait permis de le faire.
C’est, au fond, assez inouï : s’agissant de savoir ce qui définit une personne humaine, notion absolument fondamentale en matière de droit, l’instance ultime d’appréciation du respect de la Constitution a considéré que ce sont les connaissances et les techniques qui doivent permettre de l’établir ou, à tout le moins, de fonder un jugement.
Pourtant, en quoi « les connaissances et les techniques » permettent-elles de savoir ce qu’est une personne humaine ? Un médecin est-il plus autorisé qu’un prêtre, un imam, un rabbin ou un plombier chauffagiste, à établir ce qu’est une personne humaine ? Ne s’agit-il pas d’une question dont la profondeur, la portée et même le mystère obligent, dans un régime démocratique, à une délibération rigoureusement ouverte, sans distinction de statut de l’orateur ou de l’interlocuteur ?
Cet épisode illustre un phénomène prégnant depuis quelques décennies : la primauté du recours au « dire d’expert » sur le recours au témoignage.
On peut penser que ce phénomène, qui entame l’importance des convictions de chacun au bénéfice des « sachants », n’est pas totalement étranger à la colère qu’auront manifestée, depuis des mois, les « Gilets jaunes. »
Les formes politiques de « contre-culture » en réaction au primat de l’expert
Parallèlement à ce phénomène, sont apparus dès les années 80 des mouvements ou groupes citoyens politiques y réagissant de façon sévèrement critique. Ce fut notamment le cas de mouvements de sensibilité écologiste.
L’un des philosophes ayant largement inspiré de nombreux courants écologistes en Europe s’appelle Hans Jonas. Il a théorisé ce qu’il a appelé « l’heuristique de la peur », dont s’est publiquement réclamé, en son temps, Yves Cochet : l’idée selon laquelle, pour prendre une bonne décision, la connaissance importe moins que l’émotion. Pour Hans Jonas, il est juste de penser que l’avenir soit intégralement à craindre et que, pour agir contre le danger qui le menace, il faille inspirer cette crainte plutôt que d’en démontrer le bien-fondé.
Cette posture s’est traduite, dans certains mouvements, par des approches « jusqu’au-boutistes » privilégiant l’instruction de la décision collective par le recours aux opinions ou aux positions des personnes les plus éloignées du domaine de connaissances concerné. Pour le dire de façon caricaturale, ces formations entretenaient une forme de culture de groupe pour lesquelles, si une décision était à prendre à propos d’une toiture défectueuse, il était bon de demander à l’électricien ce qu’il convenait de faire plutôt qu’au couvreur, au motif de la lutte contre la confiscation de la décision par les experts.
Naturellement, cette illustration est excessive. Mais elle a le mérite de pointer un réel phénomène de contestation, dans l’opinion, du statut réservé aux « experts », aux « sachants », que matérialisent un diplôme, une place dans la société, une fonction et, peut-être plus encore, la rémunération voire « les privilèges » qui les accompagnent.
Le développement des réseaux sociaux a considérablement appuyé ce phénomène. Il s’y développe une sorte de méfiance a priori vis-à-vis de toute forme de parole autorisée, instituée.
Ce sont deux types d’autorité qui sont ainsi contestées : les institutions mêmes et les personnes qui les représentent et s’expriment en leur nom (agences publiques, instituts, organisations relevant de l’enseignement ou de la recherche…), et les données publiques ou « faisant autorité » (statistiques nationales, sondages, données budgétaires et comptables de l’État ou de collectivités…).
Bilan : le danger à écarter, l’opportunité à saisir
Le danger à écarter, c’est celui du profit électoral que l’opportunisme populiste peut tirer de cet état de confusion. C’est celui des « fake news », de la légitimation de la violence à l’égard de tous les symboles et des moyens d’action des autorités instituées, de la mise à l’index de toutes les « élites. »
Mais l’opportunité à saisir, c’est celle de la transformation en profondeur de l’exercice de l’autorité ou, plus exactement, des responsabilités.
L’exemple de la Loi de bioéthique de 1994 illustre la gravité d’une tendance à dessaisir le pouvoir du juge ou, au-delà, du législateur au profit de l’influence de l’expertise. « Ma politique est la bonne parce que j’ai fait les bons calculs. » Dans un bureau, loin de la confrontation directe avec ceux qui vont la conduire et ceux qu’elle concerne.
Mais le choix de l’émotion contre celui de la raison, de « l’égalitarisme d’opinion » contre le respect de la connaissance, est excessif et n’est pas souhaitable non plus.
Le meilleur moyen de dépasser le danger et de saisir l’opportunité de cet état de crise, c’est sans doute celui d’une méthode : une méthode de management et de décision collective. Une méthode consistant à laisser la main à « la périphérie » plutôt qu’au « centre », en misant sur la transparence de l’information et la facilitation de l’accès à la connaissance et à la formation, par le développement de l’autonomie critique et de l’esprit de responsabilité.
Cela pose la question de l’organisation de l’État et des services publics, ce qui sera abordé plus loin.
Crise de la représentativité : le seuil insupportable des renoncements et des dénis
En sus de cette usurpation du pouvoir de décider par l’expertise, parallèlement à la contestation de toutes les formes d’autorité instituée, la gauche et la droite se sont rendues coupables, depuis des décennies, de renoncements et de dénis qui ont progressivement sapé la confiance pourtant nécessaire dans les outils d’accès au – et d’exercice du – pouvoir.
Ce que la gauche n’a pas dit
Sous la cinquième République, la gauche n’est parvenue au pouvoir qu’en 1981. C’était déjà une sorte de « gauche plurielle » dans la mesure où le Parti socialiste et le Parti communiste étaient unis par un « programme commun. »
Or, ce programme prévoyait, pour une large part, l’application d’une politique économique typiquement keynésienne, de redistribution et de relance par la demande. Ce sont des points qui sont évoqués dans l’article portant sur la monnaie : l’instauration progressive, à partir de 1978, du Système monétaire international des accords de la Jamaïque de 1976, a rendu caduque cette politique keynésienne. Cela s’est traduit par le « virage de la rigueur » du début des années 80 puis par la politique du « franc fort » jusqu’à la mise en place de la monnaie unique, l’euro.
Mais la gauche n’a jamais dit ce qu’elle faisait. Jusque récemment, si vous demandiez à un parterre de sympathisants et militants socialistes si le virage de la rigueur était une parenthèse ou une conversion, vous obteniez un partage à peu près équivalent des voix.
Pendant des décennies, le PS a entretenu l’ambiguïté autour de cette question pour ne pas faire fuir tous ses adhérents qui n’avaient jamais renoncé aux grands principes du programme commun. Le débat autour de la « troisième voie, » de « l’économie sociale de marché, » de la social-démocratie n’a jamais vraiment eu lieu au sens où il n’a jamais été tranché.
Je tiens de source sûre une anecdote édifiante, qui en dit long sur le maintien délibéré de cette ambiguïté. En 2007, une discussion eut lieu entre quelques responsables socialistes sur la question de savoir s’il convenait d’appeler à voter François Bayrou. Elle avait été posée par l’un d’entre eux qui jugeait le risque trop important de voir échouer Ségolène Royal et qui considérait une victoire de Nicolas Sarkozy comme étant le pire à éviter. L’un de ses interlocuteurs lui répondit : « Si on fait cela (appeler à voter François Bayrou), on fait exploser le PS. » Il se vit répondre par un troisième : « Où est le mal ? ».
D’après ce que m’a raconté la personne ayant assisté à cette scène, il s’ensuivit quelques instants de silence et le petit groupe en resta là. Et cette personne ajouta, à mon intention : « Ils ne prendront jamais le risque de clarifier ce que pèse la social-démocratie au sein du Parti, ils ont trop peur de se compter. »
Bref : le socialisme français a toujours soigneusement conjuré toute perspective d’un « Bad Godesberg », cette étape de la gauche allemande qui lui a permis de « réécrire son logiciel », comme l’avait souhaité, en son temps, Michel Rocard. Le PS a toujours préféré, mais sans le dire, suivre scrupuleusement les consignes de « Tonton » Mitterrand qui avait d’ailleurs déclaré, en Congrès après une intervention de Michel Rocard appelant à cette réflexion réformatrice : « N’écoutez pas Michel, vous allez vous disputer. Vous allez voir que la droite va vous rendre le pouvoir plus tôt que vous ne croyez. » Cynique prophétie : c’était à peine cinq ans avant la dissolution de l’Assemblée par Jacques Chirac, ayant abouti à la seconde cohabitation.
Ce défaut de clarification, ce parti-pris de confusion, auront coûté cher à la gauche française. Car, de fait, ce que le PS n’a jamais dit, le Parti communiste puis, après lui, les formations politiques d’extrême gauche n’ont jamais su le lui faire avouer et / ou l’expliquer elles-mêmes.
Pour de nombreux sympathisants de gauche, on peut penser que ce cumul de dénis et de renoncements a fini par atteindre le seuil de l’insupportable. Certains sont probablement aujourd’hui sympathisants de la France insoumise, d’autres ont participé à la campagne d’Emmanuel Macron.
Ce que la droite n’a pas fait
Parallèlement, sur un tout autre ensemble d’enjeux, la droite a également déçu, mais moins par déni que par renoncement.
Ces dernières décennies, la droite a porté l’expression d’une volonté de plus grande liberté de l’initiative et de l’action privées, accompagnée de nécessaires réformes de l’État pour qu’il coûte moins et qu’il soit plus efficace. On retrouve ici, du reste, une bonne part du diagnostic et du programme d’Emmanuel Macron.
Or, la droite a largement échoué dans ses tentatives de réformes, de réduction de la dépense publique et de la dette, du moins du point de vue des espoirs qu’elle a fait naître sur ces points.
Il est facile de jeter la pierre et de juger, après coup. Une fois que le match est perdu, on sait très bien comment il aurait fallu le préparer pour inverser le score. Mais le fait est que les déçus de la droite, qui ne votent plus ou qui sont allés grossir les rangs de l’extrême droite, sont à peu près aussi nombreux que les déçus de la gauche, qui ont fait de même de l’autre côté de l’échiquier politique.
La droite a beaucoup annoncé combien de postes de fonctionnaires elle allait supprimer, combien d’économies dans les dépenses publiques elle allait réaliser, de combien de charges elle allait alléger les comptes des entreprises. Mais, pour cause de crise financière mondiale, de fronde sociale de grande ampleur, d’élections intermédiaires à ne pas sacrifier, elle a promis bien plus qu’elle n’a tenu, aux yeux d’une bonne partie de son électorat.
En plusieurs décennies, entre une gauche qui n’a pas dit ce qu’elle faisait et une droite qui n’a pas fait ce qu’elle avait dit, de plus en plus de citoyens se sont sentis dégoûtés de la politique jusqu’à laisser exploser leur colère, à la faveur d’une action gouvernementale jugée, une fois de trop, inadéquate.
Parmi ces électeurs de droite les plus déçus, certains sont aujourd’hui de fervents soutiens du Rassemblement national ; d’autres ont participé à la campagne d’Emmanuel Macron.
Le pouvoir que n’a pas le pouvoir : la maîtrise de la complexité de l’Appareil d’État
Mais au-delà de ces renoncements et de ces dénis, il est un enjeu qui mérite d’être abordé séparément : celui du pouvoir que n’a pas le pouvoir.
C’est la question du contrôle, par les représentants de la Nation, de l’action publique.
Le pouvoir des rapporteurs spéciaux et du rapporteur général : l’exercice d’un contrôle de gestion
Ce que prévoit la Constitution, c’est que le contrôle du gouvernement et de l’action publique est effectué par le Parlement. Concrètement, ce contrôle prend essentiellement deux formes :
-
Celle des « Questions au gouvernement », séances publiques très codifiées au cours desquelles les parlementaires soumettent les membres du gouvernement au feu du roulement de leurs questions ;
-
Celle du pouvoir que détiennent les « rapporteurs spéciaux » et le « Rapporteur Général du budget » : un pouvoir d’accès à l’information (portant sur ce que coûte, par exemple, tel dispositif de politique publique) et d’autorité sur le budget de l’État (consacré dans le vote du budget, instruit par les rapporteurs spéciaux et le rapporteur général).
S’agissant des « QAG », on est en réalité en présence d’une mise en scène très théâtralisée ayant relativement peu d’impact sur la politique conduite. Ces séances publiques peuvent très ponctuellement mettre un Ministre en difficulté, contraindre le gouvernement à clarifier un point d’actualité, mais elles n’aboutissent pas à infléchir une politique publique ou à déclencher une action d’envergure.
S’agissant du budget, sur lequel est en réalité concentré quasiment tout le pouvoir du Parlement, on est en présence de ce qui s’appelle, en entreprise, le contrôle de gestion : sur la base d’une grille de lecture exclusivement financière, il s’agit d’un quasi contrôle de conformité qui n’oriente ni ne sanctionne l’exercice des responsabilités opérationnelles.
En d’autres termes, le Parlement n’exerce en réalité pas de contrôle organisationnel, managérial, de l’action publique. S’agissant de l’efficacité, de la cohérence, de l’optimisation de cette action, le pouvoir est concentré dans les mains des Ministres et, au-delà, dans les multiples instances d’inspection et de contrôle des administrations elles-mêmes. Mais un parlementaire n’a pas accès aux enjeux managériaux de l’action publique : adéquation homme – poste, injonctions contradictoires, querelles intestines… bref, tous les enjeux RH qui conditionnent l’efficacité de l’action et, notamment, la principale composante de cette efficacité : le bien-être au travail.
Deux exemples illustrent cet état de fait.
Un exemple récent : celui de la Loi MUES
En pleine crise des Gilets jaunes, le 10 décembre dernier, le Président de la République est intervenu pour annoncer un certain nombre de décisions qui devaient se traduire par une modification substantielle du budget de la Sécurité sociale. Il a notamment annoncé, ce jour-là, que serait réattribué aux retraités percevant plus de 1200 euros mais moins de 2000 euros de pension mensuelle, le taux supplémentaire de 1,7% de CSG qui avait été prélevé en 2018.
La Constitution prévoit que le budget de la Nation doit être adopté par le Parlement dans un délai maximum de 70 jours au total. Les dispositions annoncées par le Président de la République devaient donc être intégrées au Projet de Loi de Finances de la Sécurité sociale (le PLFSS, dans le jargon parlementaire) en l’espace d’une dizaine de jours, sous la forme d’une Loi qui a été appelée « Loi de Mesures d’urgence économique et sociale » (la Loi MUES).
Il est à noter ce que l’adoption de cette loi qui représentait plus de 10 milliards d’euros, dans un tel délai, est un record. Les contraintes de calendrier étaient telles qu’il n’était pas possible de prévoir une « navette parlementaire », c’est-à-dire un aller-retour entre l’Assemblée nationale et le Sénat, systématique lorsque le Sénat modifie la Loi adoptée en première lecture par les Députés : les Sénateurs s’étaient engagés à voter le texte « conforme », c’est-à-dire sans le modifier, de sorte qu’il soit définitivement adopté et puisse être promulgué après seulement une lecture dans chaque assemblée.
Concrètement, le texte de la Loi MUES a été présenté en Conseil des Ministres le mercredi 19 décembre, il a été examiné en séance publique à l’Assemblée nationale le jeudi 20 décembre, voté par les Députés le vendredi 21 décembre à 5h30 du matin environ, puis examiné et voté par les sénateurs le même jour.
Or, il s’avère que le texte soumis à l’examen des Députés le jeudi 20 décembre à partir de 15 heures comprenait une « coquille » assez lourde de conséquences.
Pour le comprendre, il est nécessaire de prendre connaissance d’une précision technique un peu complexe.
Dans la Loi, pour savoir si un retraité est assujetti à la CSG, on se réfère à une année fiscale de référence : l’année N-2 par rapport à l’année à laquelle s’applique le prélèvement de CSG. Mais pour savoir si un retraité est assujetti au taux réduit de 3,8 points, on se réfère à deux années fiscales de référence : l’année N-2 et l’année N-3. Puis, pour savoir s’il est assujetti au taux normal de 6,6 points ou au taux majoré de 8,2 points, il est à nouveau fait référence à une seule année fiscale de référence.
Si bien que le texte de la loi MUES, modifiant une modification adoptée en 2017 pour prélever 1,7 points supplémentaires de CSG, était proprement illisible. D’une technicité assommante, il comprenait quatre articles dont l’article 3, portant sur cette question de la CSG, était particulièrement complexe.
La « coquille » de ce texte résultait de la conjugaison des alinéas 3 et 3bis de l’article 3. Tel qu’il était rédigé, le texte prévoyait que les retraités passant au-delà du seuil de 1200 euros de pension mensuelle en année N-3 se voyaient prélever, en 2019, 6,6 points de CSG au lieu de 3,8 points.
En réalité, cette erreur était due à la correction à la hâte, entre le mercredi 19 décembre au soir et le jeudi 20 décembre au matin, d’une erreur moins conséquente mais malgré tout sérieuse, qui empêchait tout bonnement de savoir si un tel retraité devait être taxé à 3,8 points ou à 6,6 points.
Prévenue de cette « coquille » dans le texte, la Ministre l’a amendé en séance et, pour finir, la loi adoptée ne souffre pas de défaut de rédaction.
Mais si cet épisode vaut la peine d’être raconté, c’est pour la raison suivante : si l’on peut raisonnablement penser que cette erreur était initialement due à un contexte d’urgence inédit, on peut aussi penser qu’il aurait été utile de se pencher sur les conditions dans lesquelles elle a été commise et en tirer des conclusions pour qu’à l’avenir, même dans un contexte d’urgence, elle ne soit pas réitérée.
Seulement, voilà : les parlementaires n’ont pas accès à l’Administration pour cela. Le contrôle du gouvernement et de l’action publique par le Parlement ne prévoit pas qu’un parlementaire puisse procéder à un examen rétrospectif des conditions dans lesquelles a été rédigé un texte de Loi comprenant une erreur potentiellement préjudiciable pour la crédibilité même de la parole présidentielle.
Ce n’est pas exagéré que d’invoquer ce préjudice : si le Sénat avait été prévenu de cette erreur comme l’a été l’Assemblée, il est raisonnable de penser qu’il n’aurait pas voté le texte conforme et que la modification du budget 2019 n’aurait pas été possible.
En définitive, le pouvoir législatif se heurte à la relative opacité de l’exercice des missions de l’exécutif qui, s’il prévoit lui-même des procédures et des missions de contrôle interne, ne permet pas au Parlement d’auditer son fonctionnement.
En l’occurrence, ayant moi-même tenté de m’immiscer dans ce fonctionnement pour y voir clair et contribuer aux leçons qu’il convient d’en tirer, je me suis trouvé confronté à un interlocuteur qui m’a déclaré : « Vous savez, Monsieur le Député, des bugs dans les textes de lois, il y en a eu, il y en aura… ».
Un exemple plus ancien : celui de la vente des autoroutes
La très fameuse vente des autoroutes, décriée presque chaque fois qu’il en est question, s’est déroulée en plusieurs étapes et sur plusieurs années mais, surtout, par plusieurs gouvernements… de gauche, puis de droite.
Cette vente a commencé par des privatisations partielles : des « ouvertures du capital. » En 2002, sous le gouvernement de Lionel Jospin, c’est ASF (Autoroutes du Sud de la France) qui est partiellement privatisé.
Le mouvement se poursuit sous les trois gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, entre 2002 et 2005, avec les privatisations partielles des Autoroutes de Paris Rhin-Rhône (APRR), puis du Nord et de l’Est de la France.
Enfin, l’opération s’achève sous le gouvernement de Dominique de Villepin, avec la privatisation totale de toutes les sociétés, c’est-à-dire la cession des parts restées propriété de l’Etat.
Ce qui est remarquable dans cette affaire, c’est sa continuité sur plusieurs gouvernements et, notamment, malgré une alternance politique. Or, on peut penser que cette continuité, que n’a pas interrompue le moins du monde un changement de majorité, est tout simplement due à la continuité de… l’Appareil d’Etat. Ce sont les mêmes « instructeurs », hauts fonctionnaires, qui ont, selon toute vraisemblance, œuvré au contact de différents Ministres, sous pas moins de quatre gouvernements.
Je tiens de l’un des membres de l’un de ces gouvernements une anecdote qui fonde solidement cette hypothèse. Au contact de plusieurs Ministres de l’Economie et des Finances, eux-mêmes ayant eu pour collègues plusieurs Ministres successifs des Transports, un même « conseiller » a littéralement « poussé » le même dossier, de vente totale des sociétés d’Autoroutes… et ce, dès les années où ces sociétés n’ont été vendues que partiellement.
La responsabilité politique de cette opération est intégralement portée, depuis, par les personnalités politiques qui l’ont assumée et, en particulier, par Dominique de Villepin qui est le dernier Premier Ministre à avoir « couvert » cette vente par étapes, sur plusieurs années.
Mais cette responsabilité est celle de celui qui assume. Celle de celui qui « fait prendre » la décision, qui l’argumente, qui l’instruit, qui en établit le bien-fondé, n’apparaît pas.
Du Conseil d’État aux Cabinets ministériels, en passant par les Secrétariats intimes
J’ai écrit un article, sur le sujet du contrôle de l’action conduite par la Haute administration, en réaction à la publication d’un point de vue d’un Haut fonctionnaire. Le journal Les Échos, m’ayant déclaré qu’il publierait ma tribune, n’en a finalement rien fait.
J’évoque, dans cet article, la curiosité que représente les cabinets ministériels sous la cinquième République. Je souhaite, ici, revenir sur ce point.
Initialement, le Conseil d’État, tel que voulu par Napoléon Bonaparte, avait une double mission : celle de trancher les contradictions internes au droit administratif, ce qu’il continue de faire aujourd’hui, mais également celle d’interpréter la volonté du législateur et de se voir confier le monopole de la rédaction de son énoncé, ce qu’il ne fait plus du tout.
Ce sont les « Secrétariats intimes », devenus les Cabinets ministériels, qui ont longtemps été chargés d’imposer à l’Administration l’expression écrite de la volonté du souverain – celle du peuple en tant que représenté par le Parlement. Depuis plusieurs décennies, cette situation a considérablement évolué.
Ce ne sont plus, du tout, les Cabinets ministériels qui « tiennent la plume » : au mieux, ils « tiennent la main qui tient la plume. » Et encore : c’est de moins en moins vrai. Alors que le Parlement adopte essentiellement des lois dont le gouvernement a l’initiative (c’est le cas de près de 95% des lois adoptées), c’est la Haute administration qui les rédige.
Or, la rédaction d’une loi est d’un tel niveau de complexité technique que les compétences requises pour l’écrire sont, pour ainsi dire, quasiment confisquées, de fait, par l’Administration. Cette question de l’autonomie de compétences du Parlement est au centre de la réforme des Institutions que soulève, entre autres, la crise que nous traversons.
« Bienvenue dans la cinquième République : c’est le mépris du Parlement… »
Le dernier exemple que je souhaite prendre est celui de l’accès à l’information, par les parlementaires, dont dispose la Haute Administration.
Au début de l’année 2019, j’ai pu échanger à l’occasion d’une conférence téléphonique avec plusieurs interlocuteurs du Ministère de l’Économie et des Finances. Au cours de ce rendez-vous téléphonique, je souhaitais aborder deux points :
-
Celui de la façon dont avait été élaboré un document pédagogique largement diffusé à ce moment-là, dans lequel les principales dépenses publiques étaient ramenées à 1000 euros : dans ce document, on peut par exemple découvrir que, sur 1000 euros de dépenses publiques, les retraites représentent 268 euros ;
-
Celui des emprunts de la France au cours de l’année 2018, le rapport d’activités de l’Agence France Trésor ne me permettant pas de savoir combien la France avait contracté d’emprunts de court terme.
Je n’ai obtenu satisfaction sur aucun des deux points. Il m’a été annoncé : « on revient vers vous. » Plus de trois mois plus tard, je ne sais pas où mes interlocuteurs sont partis mais je n’ai pas observé le moindre « retour. »
Sur le premier point, je souhaitais savoir quelles étaient les clés de répartition des dépenses en nature dans les principales fonctions listées dans le fameux document pédagogique. Par exemple, je souhaitais savoir si les 268 euros de dépenses publiques sur 1000 ne correspondaient qu’aux versements (c’est-à-dire, aux pensions de retraite) ou si ce montant de 268 euros comprenait des dépenses de fonctionnement (par exemple, des salaires de la fonction publique).
Pour avoir dirigé des organisations de plusieurs millions d’euros de budget, je sais très bien qu’il existe une relative marge de manœuvre pour décider de l’affectation, par exemple, des salaires des fonctions support (comptabilité, RH…) à telle ou telle fonction opérationnelle (la communication, la production…) pour faire varier le pourcentage de dépenses totales correspondant à telle ou telle mission.
Je n’ai pas de réponse à cette question.
Sur le second point, je souhaitais savoir quel était « le roulement » de la dette française : de combien a-t-on besoin, pour faire fonctionner l’Appareil d’État, à un mois, trois mois, six mois, un an. En consultant le site de l’Agence France Trésor, on peut par exemple rapidement découvrir qu’en 2018, la France a effectué 221 milliards d’emprunts de moyen et de long terme. Mais pour savoir combien elle a emprunté sur les marchés de court terme, c’est très difficile de le savoir : cela n’apparaît pas clairement.
Grâce à l’aide d’un ami économiste familier, de par ses fonctions, de ce type de documents, je pense que la France a emprunté pour près de 180 milliards d’euros sur les marchés de court terme. Or, le taux d’intérêt appliqué aux emprunts de court terme sur ces marchés est négatif : en empruntant, on génère en réalité des produits financiers. Ils sont vraisemblablement générés prudemment et exclusivement dédiés au roulement de la dette.
Mais il m’est impossible de le savoir. Je suis un élu de la Nation, il s’agit de l’état du pays, et je ne peux pas avoir accès à cette information. « On » va « revenir » vers moi…
En évoquant cette situation avec un collègue qui est un habitué des rouages de l’État et qui, de surcroît, connaît particulièrement bien ces enjeux financiers et budgétaires, je me suis vu répondre cette phrase qui m’a laissé songeur : « Bienvenue dans la cinquième République : c’est le mépris du Parlement. »
« Mettre fin aux grands corps »
Dans ce contexte, l’annonce du Président de la République lors de sa Conférence de presse du jeudi 25 avril à propos de l’ENA et, surtout, des grands corps d’État, est d’une portée considérable.
On aura beaucoup commenté la prétendue « suppression » de l’ENA. En général, sa nécessaire réforme (ce sont les grands corps auxquels le Chef de l’État a déclaré qu’il était bon de « mettre fin », pas l’ENA qu’il s’agit de transformer) est évoquée pour parler de la diversité sociale des élites.
Mais la remise en cause des « grands corps », auxquels il est donc question de « mettre fin », va bien au-delà.
Il s’agit tout bonnement d’arrêter d’admettre que la réussite à un concours, aussi difficile soit-il, alors qu’on n’a même pas trente ans, permet de garantir à vie non seulement un emploi, mais un emploi de décisionnaire absolument déterminant dans le fonctionnement de l’Appareil d’État.
C’est, je le crois, proprement révolutionnaire.
C’est toute un pan de la culture de la fonction publique française qui est visée.
Cette culture pour laquelle les « mérites » qu’il s’agit de repérer pour confier aux « meilleurs » les rênes de la Nation peuvent l’être, de façon définitive, par le truchement d’un concours auquel on peut prétendre sans avoir d’expérience professionnelle ni avoir exercé la moindre responsabilité.
Cette culture pour laquelle ce dont la Nation a le plus besoin, c’est d’esprits brillants qui « savent » parce qu’ils ont prouvé, une fois pour toutes, qu’ils apprenaient vite et bien.
Cette culture pour laquelle on ne va pas confier de responsabilités dans le fonctionnement de l’État (un fonctionnaire n’est-il pas fait pour « faire fonctionner » ?) à quelqu’un qui n’a pas « réussi » une compétition fondamentalement individualiste et composée d’épreuves qui testent l’acquisition et la mobilisation de connaissances étendues et complexes.
Elle est visée parce qu’elle souffre de sérieux aveuglements.
Les « mérites » qu’il faut repérer doivent aussi – et enfin ! – porter sur des dispositions managériales, qui relève avant tout de la personnalité et que seule sanctionne l’expérience.
Ce dont la Nation a le plus besoin, c’est de croire à nouveau en elle-même et, pour cela, d’arrêter d’admettre que tout peut se jouer entre 20 et 30 ans, s’agissant d’accéder aux commandes de l’État.
Et, s’agissant de confier des responsabilités, notamment managériales, c’est d’intelligence collective, de capacité à susciter d’une équipe le meilleur d’elle-même, de qualités de comportement et relationnelles, dont nous avons le plus besoin.
Quelles sont les qualités que doit avoir le Pouvoir : celles qu’il faut pour le prendre, ou bien celles qu’il faut pour l’exercer ?
Ce dont témoignent les innombrables « mouvements citoyens » qui ont émergé ces dernières décennies
Depuis très longtemps, une organisation qui prétend exercer le pouvoir (un Parti politique) ou représenter un groupe social au contact de l’État (un syndicat professionnel ou de salariés) privilégie, dans le repérage des talents au sein de ses adhérents, les qualités requises pour prendre le pouvoir.
Ces qualités sont à peu près les suivantes : le charisme, le sens de la répartie, la capacité à prendre la parole en public et à s’imposer, la combativité, la persévérance, le pouvoir de séduction ou de persuasion.
On pourra noter, d’emblée, que toutes ces qualités peuvent être réunies sans que soient présentes d’autres qualités, pourtant a priori nécessaires à l’exercice de responsabilités : le sens de la décision, l’orientation « résultats », la capacité à se remettre en cause, la sincérité ou l’authenticité, la force de conviction.
Or, de très nombreuses tentatives de création de nouvelles formes d’organisations politiques ou associatives, ces dernières années, ont pris le contre-pied de ces valeurs. Elles se sont traduites dans des mouvements souvent appelés « citoyens » dont les adhérents ne voulaient plus seulement soutenir mais contribuer. Elles se sont voulues plus « participatives » et la question de la démocratie interne à ces organisations était souvent centrale dans leur objet même.
Ce que ces nouvelles formes d’engagement ont fait apparaître, c’est que le repérage des talents ou des dispositions requises pour se voir confier des responsabilités ne devait plus du tout porter sur les mêmes qualités.
Pour qu’une organisation privilégie la participation, l’horizontalité, la démocratie interne, il faut que celles et ceux qui exercent la responsabilité de son fonctionnement présentent les qualités suivantes : capacité d’écoute, capacité à rapprocher les points de vue, sincérité et authenticité, capacité à se remettre en cause, sens du collectif.
On voit que ce ne sont plus du tout les mêmes.
En réalité, on le sait depuis longtemps, voire depuis toujours : les qualités qui font un bon candidat à une élection ne sont pas totalement superposables à celles qui font un bon élu.
En première approche, on peut penser que c’est un sérieux problème. Si l’élection est le meilleur moyen (ou le pire, à l’exclusion de tous les autres) de se choisir « un chef », il est ennuyeux qu’elle ne permette pas de sélectionner les qualités qu’il faut pour être un bon chef, en privilégiant celles qu’il faut pour le devenir… en sachant que ce ne sont pas – ou pas intégralement – les mêmes.
Le scrutin est, en soi, une piste de réflexion intéressante, pour traiter de cet enjeu.
L’enjeu du scrutin, dont on a – curieusement – si peu parlé
Il a beaucoup été question de la Constitution et de nos Institutions, dans le cadre du Grand débat national. Mais le scrutin lui-même, c’est-à-dire la technique qui est appliquée au vote pour en définir le gagnant, est d’une importance considérable, alors qu’il n’a quasiment pas été abordé.
Rappelons qu’il en existe de multiples formes, de par le monde et ne serait-ce qu’en Europe.
Les Chefs d’État ou de gouvernement sont parfois élus au scrutin proportionnel (même partiel) : c’est le cas en Allemagne ou en Israël. En Allemagne, c’est en réalité une mixité de scrutins qui entre en jeu : un scrutin plurinominal proportionnel et un scrutin uninominal majoritaire, ce qui est assez complexe.
Il en résulte, en tout état de cause, de nécessaires coalitions : à la proportionnelle, la majorité absolue n’est jamais garantie. La culture politique de ces pays est donc celle de la négociation, du compromis : une fois les élections passées, les formations gagnantes sont tenues de se mettre d’accord sur un programme de gouvernement.
A l’inverse, le Royaume Uni adopte le scrutin uninominal à un tour : c’est la plus violente des formules, celle selon laquelle « the winner takes it all. » Même s’il n’arrive en tête qu’avec une courte majorité relative.
On peut penser que la façon dont le Brexit a été négocié n’est pas étrangère à ce mode de scrutin : l’obsession d’unifier le Parti conservateur, qui avait d’ailleurs motivé le référendum, a conduit les Tories à quasiment confisquer le débat. Theresa May a agi pour maintenir l’unité de son Parti et ne s’est donc pas ouverte à une négociation « au centre » avec le Parti Travailliste.
En France, plusieurs études et travaux de recherche permettent d’avoir une réflexion intéressante à propos des dernières élections présidentielles. Les modes de scrutin testés (scrutin par jugement majoritaire, scrutin par élimination…) aboutissent à des résultats très différents et certains ont le mérite de révéler quelle candidature est de nature à fédérer le plus d’électeurs.
Réfléchir à cet enjeu du mode de scrutin permet en tous cas de se demander quelle personnalité, quelles qualités de la candidature sont « gagnantes », selon la façon dont le choix collectif est opéré. On peut penser que, selon la crise ou les difficultés qu’il faut surmonter, c’est un profil très « clivant » ou, au contraire, plus fédérateur, qu’il est préférable d’élire.
La culture du résultat ou de l’efficacité : ce que nous apprend le monde de l’entreprise
Mais le plus important, s’agissant du fonctionnement de notre Appareil d’État et de l’organisation de notre démocratie, réside sans doute dans un changement profond de la culture même de nos institutions et de notre fonction publique.
Je prendrai l’exemple du monde de l’entreprise pour l’illustrer.
Depuis plusieurs années, à la faveur du développement du numérique et de ce qu’on appelle « la digitalisation », de plus en plus d’entreprises ont adopté le principe de ce qu’on appelle « l’UX » : « User eXperience », le « penser utilisateur. »
Il s’agit, pour une entreprise, de concevoir sa propre organisation interne, ses processus de décision, sa stratégie à partir de l’expérience que font ses clients de ses produits et services.
La marque Apple est largement positionnée sur ce créneau : celui de l’interaction facile et intuitive. Le changement de logo de France Telecom en est un exemple intéressant : on est passé du logo représentant un clavier, couleur bleu institutionnel, au logo représentant le « Et » (« & ») couleur orange. Le « vieux » logo représentait un métier d’ingénieur : un savoir-faire technique, la production de machines, le caractère rassurant mais lointain de la grosse entreprise. Le « nouveau » logo (qui commence à dater, maintenant…) représente une fonction : la mise en relation, une culture d’entreprise tournée vers ses clients, le caractère chaleureux et rassurant d’une proximité.
La France est un pays de producteurs. Culturellement, historiquement, presque « mentalement. » Très peu d’entreprises se sont, encore à ce stade, montrées capables d’adopter cette façon de se penser autour de leur mission, de la fonction qu’elles remplissent du point de vue de leurs clients. Elles sont le plus souvent pensées autour de leur structure, de la façon dont elles sont organisées d’un point de vue interne.
Notre Administration en est un cas presque caricatural : elle projette son mode de fonctionnement, ses propres contraintes, sur les usagers. Qu’il s’agisse des déclarations de revenus à retourner au fisc, de tout type de formulaire de demande ou d’enregistrement de quoi que ce soit, la forme même des documents n’est absolument pas pensée du point de vue de celle ou celui qui doit les remplir, mais du point de vue de celle ou celui qui en ont besoin et qui vont les exploiter.
C’est l’un des principaux motifs pour lesquels nous avons voté la Loi dite « Essoc », du « droit à l’erreur », qui mettra probablement des années à avoir un impact concret auprès du maximum de foyers tant elle suppose un bouleversement des habitudes et de la culture de nos administrations.
C’est aussi pour cela qu’il sera long et difficile de déconcentrer notre Appareil d’État.
Pour l’illustrer, je prendrai un dernier exemple.
Parmi les projets que je conduis, il en est un qui porte sur la façon dont est organisée la restauration à l’hôpital. Ce projet m’a placé au contact d’un fonctionnaire qui m’a raconté une anecdote extrêmement éloquente.
Dans le cadre d’une mission qui lui était confiée, ce fonctionnaire qui relevait d’une Administration centrale a été conduit à planifier et animer des réunions décentralisées sur le territoire. Il s’agissait de réunir des agents concernés par sa mission qui était censée changer la façon dont ils travaillaient : c’était en quelque sorte une mission de « conduite du changement. »
Assez naturellement, ce fonctionnaire prenait donc le parti de commencer par prendre l’avis des agents concernés, de les réunir pour les écouter et bâtir un diagnostic non seulement technique et, d’une certaine manière, abstrait, mais également humain et managérial, lui permettant de s’imprégner d’une réalité impossible à appréhender autrement que par contact direct, « de terrain. »
Or, il m’a raconté que le premier réflexe des hauts fonctionnaires sous la responsabilité desquels il était placé a consisté à contester l’opportunité de ces déplacements… jusqu’à ne pas approuver d’en rembourser les frais. On lui a, en quelque sorte, objecté l’argument suivant : « Pourquoi faire ces réunions ? Vous n’avez qu’à envoyer des questionnaires, et puis faire une circulaire… »
Ce sont des changements qui prendront peut-être au moins une génération.
Ils sont en cours, mais ils ne percent pas encore.
Pour finir, j’évoquerai ce que sont, de mon point de vue, les meilleurs vecteurs de ce changement de culture dont nous avons collectivement besoin. Je les ai évoqués en tout début d’article, à propos de ce qu’a été mon parcours.
Il s’agit de techniques de communication, d’animation de réunions, d’accompagnement de groupes voire de développement que l’on appelle « personnel. »
La première de ces techniques, si l’on peut l’appeler ainsi, est la Communication non violente. C’est un mode de relation qui permet, en quelque sorte, de « parler de ce qui fâche sans se fâcher. »
Les autres relèvent de l’animation de réunions : elles ont beaucoup de vertus. On les appelle « forums ouverts », « world cafés… » elles permettent de faire tomber les masques, de déjouer les postures, d’apporter de la sincérité et d’obtenir un niveau de participation qui n’est jamais atteint, en format plus classique de réunion. Elles sont de plus en plus utilisées en entreprise.
Ce sont seulement des outils. Mais ils permettent de renouveler la façon de s’engager et d’agir collectivement. Et c’est de ce renouvellement, je crois, que peut venir celui du pouvoir lui-même et, surtout, de la façon d’y accéder et de l’exercer.


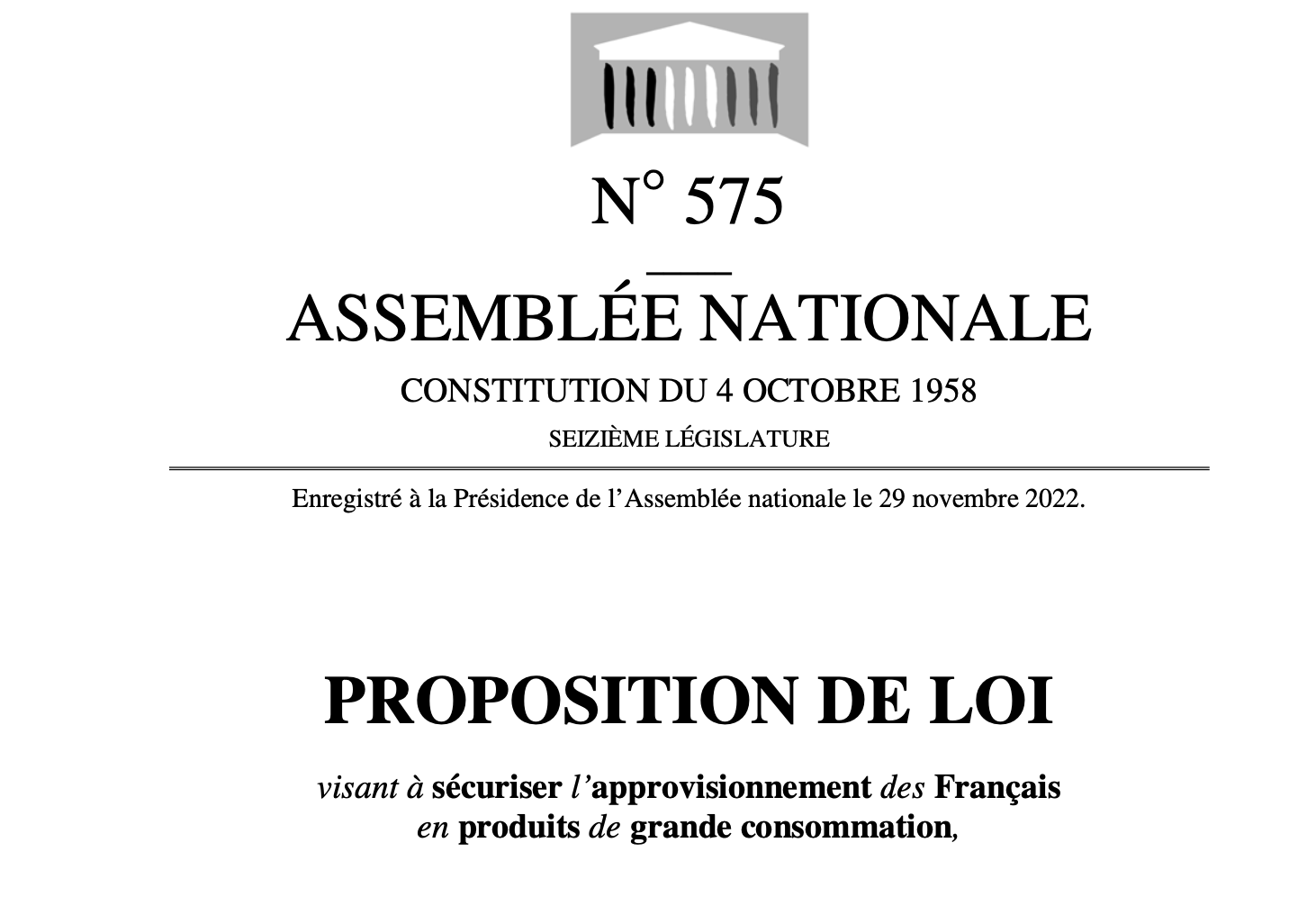
1 commentaire
En réponse aux nombreux courriers et messages qui m’ont été adressés ces derniers mois - Frédéric Descrozaille · 1 mai 2019 à 16 h 32 min
[…] Parmi les décisions annoncées par le Président de la République au terme du Grand débat national qu’il avait proposé, figure celle de « mettre fin aux grands corps. » Personnellement, j’en attends beaucoup. C’est au cœur du bilan que je dresse de mes deux premières années de mandat : le constat, qui a quelque chose de vertigineux, du pouvoir que n’a pas le pouvoir. Cliquez ici pour lire le second article […]