La question monétaire
De quel poids pèse notre dette ?
Pourquoi les inégalités de richesse détenue augmentent-elles partout dans le monde ?
Pourquoi l’augmentation des salaires n’est-elle plus indexée sur celle des gains de productivité, comme pendant les trente glorieuses ?
Pourquoi la fiscalité du capital est-elle avantageuse par rapport à celle du travail ?
Pourquoi la dette de l’État, de même que celle des entreprises, de même que celle des ménages, sont-elles constamment aggravées depuis des décennies ?
Ces questions sont au cœur de la crise que nous traversons, au cœur de nombreuses revendications, au cœur de nombreux affrontements politiques.
Je ne prétends pas y apporter de réponse définitive, ni même complète.
Je prétends seulement partager ce que j’ai compris, qui est au fondement de mon engagement politique.
Je le développe en quelques points, qui me permettent tout simplement, en quelque sorte, de raconter une histoire :
-
Les accords de Bretton Woods, de 1944 à la crise monétaire des années 70 ;
-
Les accords de la Jamaïque, ou « de Kingston », signés en 1976 ;
-
Le « virage de la rigueur » du début des années 80 et les politiques économiques conduites en Europe depuis ;
-
La crise de 2008 et la situation actuelle.
Quelques mots de mon propre parcours…
La question monétaire est complexe.
Malgré les cours que j’ai suivis tant à l’Agro qu’à Sciences Po, je dois humblement admettre que je n’y ai à peu près rien compris pendant des années.
C’est en réfléchissant à l’enjeu alimentaire mondial que je me suis remis à travailler cette question mais, cette fois, sans suivre de cours : en effectuant mes propres recherches, sous forme de rencontres et de lectures. Parmi celles qui m’ont le plus aidé, les publications de Bernard Maris, victime de l’attentat de Charlie Hebdo, figurent en bonne place.
En deux mots – il s’agit d’un autre sujet extrêmement vaste et d’une importance au moins aussi grande – la situation alimentaire et agricole mondiale est telle que les plus pauvres parmi les pauvres, à l’échelle de la planète, qui souffrent de la faim et en meurent par millions tous les ans, sont des paysans.
C’est paradoxal, en première approche : on est a priori enclin à penser qu’un paysan, dont le métier est de produire de la nourriture, est au moins capable de se nourrir lui-même. Dans les faits, il n’en est rien. Un paysan doit attendre, après avoir semé, le temps de la récolte. Si son travail est détruit par le passage d’une bande armée, une sécheresse, une inondation ou une invasion d’insectes ravageurs, il doit souvent migrer vers un bidonville ou un camp de réfugiés.
Si l’on veut donc que les paysans les plus pauvres aient de quoi épargner et investir (ce qui est souhaitable du point de vue de la sécurité internationale : les troupes de Boko Haram, ce sont essentiellement des paysans… l’une des principales causes des mouvements migratoires et de l’insécurité géopolitique, c’est la pauvreté de la paysannerie la moins compétitive du monde… mais c’est un autre sujet), il faut qu’ils puissent vendre leur production plus cher.
Mais si la production agricole est vendue plus cher, le coût de l’alimentation est renchéri d’autant… comment faire, dès lors, pour financer ce renchérissement ?
Cette question m’a conduit à revisiter mes cours sur les politiques budgétaires, de relance par la demande, sur les différentes écoles de la pensée économique et, finalement, à lire et rencontrer des spécialistes pour, enfin, y comprendre quelque chose.
La première chose que j’ai correctement assimilée, c’est qu’un système d’échanges est toujours adossé à un système monétaire : pour pouvoir vendre et s’acheter des biens et des services, il faut pouvoir comparer les valeurs en présence ; il faut donc pouvoir chiffrer ces valeurs avec la même mesure ou, à tout le moins, avec des mesures comparables entre elles.
Historiquement, ce sont différents systèmes de mesure qui ont été adoptés. Parmi les principales étapes de cette évolution, on pourra retenir celle de 1694, date de la création de la toute première Banque centrale, celle d’Angleterre, sur la base de ce que Locke avait compris et proposé ; on pourra aussi retenir celle de 1922, date de la conférence de Gênes, qui a permis de faire adopter la notion de « monnaie de réserve » à l’échelle d’un large consensus international.
La monnaie relève de trois fonctions différentes.
-
Le moyen de paiement : il permet l’acquisition d’un bien ou d’un service. En référence à cette fonction, on évoque souvent la notion de troc : l’échange direct, sans intermédiaire, de biens ou de services. Ce que permet la monnaie, que ne permet pas le troc, c’est une extension potentiellement universelle des possibilités d’échange à des populations très éloignées et à une variété infinie de biens et de services. On peut concevoir que l’échange de services (tu gardes mon chat pendant mon absence, j’arroserai tes fleurs pendant ton absence) ou de biens (j’ai besoin d’un peu de ton lait, je te donne des œufs) est facile lorsqu’il y a suffisamment de proximité entre les opérateurs (des voisins) ou les biens et les services échangés (des denrées alimentaires, des tâches domestiques) ; mais c’est beaucoup plus difficile, sans monnaie, dès que l’éloignement augmente entre les opérateurs (j’importe, j’exporte) ou que la différence de nature s’accentue entre les biens ou les services (une compétence en informatique pour intervenir sur mon ordinateur contre un vêtement ou une place pour le prochain match de foot au Parc des Princes).
-
L’unité de compte : cette extension de la possibilité des échanges repose sur celle de la comparaison entre les valeurs de biens ou de services non comparables entre eux. La monnaie permet de mesurer ce que vaut une unité de bien ou de service (un œuf, un litre de lait, une heure d’intervention sur mon ordinateur, une place au stade…) et, donc, de les échanger.
-
La réserve de valeur : cette fonction permet de différer la transaction. Je peux vouloir acquérir un bien ou un service, mais pas tout de suite : pour cela, il est pratique de garder un stock de valeur me permettant de procéder à l’achat ou la vente plus tard, voire ailleurs. Entre-temps, la possibilité de détenir cette valeur sans qu’elle s’érode est fondamentale : c’est la possibilité d’épargner, de thésauriser ou d’investir.
Mais je commencerai mon histoire en 1944, date des accords de Bretton
Woods.
Le système de « change
– Or » jusqu’à la crise monétaire des années 70
L’instauration du système de « Change – Or »
L’impact de la crise des années 1930, après le fameux « vendredi noir » de 1929, a notamment été dévastateur pour le système monétaire international de l’époque. Il est apparu plusieurs « blocs » monétaires, plus ou moins perméables entre eux, dans un contexte de dévaluations / réévaluations provoquées ou subies : le bloc-Or, le bloc-Sterling et la zone Dollar.
Roosevelt dévalue le dollar en 1933 et 1934, l’once d’or passant de 20,67$ à 35$ ; ce cours restera inchangé jusqu’en 1971.
Et, en 1944, sous son impulsion, sont signés les accords de Bretton Woods : c’est la création des quatre institutions mondiales qui relancent « la mondialisation » dont il est tellement question depuis quelques décennies. Ces quatre organisations mondiales sont dictées par les leçons tirées des deux guerres mondiales et de l’instabilité économique et monétaire de l’entre-deux guerres :
-
Pour prévenir ou circonscrire les conflits, est créée l’Onu ;
-
Pour relancer le commerce international, est créé le Gatt, sorte de Secrétariat mondial où il ne doit être question que de baisse de tarifs douaniers, transformé en OMC en 1994 à l’occasion des accords de Marrakech ;
-
Pour stabiliser les relations monétaires entre les États et harmoniser les politiques économiques, sont créés la Banque mondiale et le FMI.
Or, dans les statuts du FMI établis en 1944, le dollar est une monnaie de réserve, pour ainsi dire, de droit : il est convertible en or selon un taux de change fixe (35 dollars l’once d’or). Les autres monnaies des États membres du FMI sont « réputées » convertibles en or en étant arrimées au dollar selon des taux de change fixes mais « ajustables. » Le système monétaire international ainsi mis en place est celui du « Change – Or » : toute la richesse des États membres du FMI est indexée sur la valeur de l’or, via la convertibilité – or du dollar.
On pourra objecter que ce système était déjà mis en place par la Conférence de Gênes de 1928. C’est vrai, mais cela n’invalide pas l’analyse selon laquelle les accords de Bretton Woods l’ont en quelque sorte consacré dans les statuts même du FMI.
Dans ce contexte, la totalité des actifs détenus par les banques centrales fédérales américaines est convertible en or : on parle d’un « taux de couverture des liquidités » de 100%.
L’agonie du système de « Change – Or » et la crise monétaire des années 70
Mais les américains font « tourner la planche à billets… » ils mettent, progressivement, bien plus de dollars en circulation qu’ils ne détiennent de quantité d’or permettant d’en garantir la valeur.
Il faut financer la guerre de Corée, puis celle du Vietnam, tout en appliquant le programme de Kennedy (essentiellement poursuivi par Johnson), dispendieux : au cours de la décennie des années 60, le fameux « taux de couverture des liquidités » des banques fédérales américaines passe de 100% en 1959 à 11% seulement en 1971.
En clair, en 1971, les américains ne peuvent réellement convertir en or que 11% des dollars qu’ils ont mis en circulation.
En février 1965, instruit sur cette question par son conseiller Jacques Rueff qui pensait beaucoup de mal des accords de Bretton Woods, De Gaulle dénonce, à l’occasion d’une conférence de presse retentissante, la politique économique et monétaire américaine.
Il exige que les États-Unis rétablissent l’équilibre de leur budget, celui de leur balance des paiements et dévaluent leur monnaie en faisant passer l’once d’or de 35 à 70 dollars.
En effet, De Gaulle constate que ses réserves fondent, du fait d’une politique des Etats-Unis qui revient à « importer » en quelque sorte la richesse de leurs alliés pour financer une activité qu’ils ne pourraient pas financer eux-mêmes, mais sans que le pouvoir d’achat de leur monnaie ne diminue, en étant protégé par les statuts mêmes du FMI. Il leur déclare donc, en substance : « Cessez de dépenser plus de richesses que vous n’en générez et dévaluez le dollar, parce que ma richesse est comptabilisée dans votre monnaie, qui devient une monnaie de singe. »
Plus tard, le Secrétaire d’État au Trésor de Nixon, John Connally, déclarera : « the dollar is our money and it is your problem » (le dollar est notre monnaie et c’est votre problème). On ne peut pas être plus clair…
Dès 1971, le monde connaît de nouveau une crise monétaire internationale.
Nixon suspend la convertibilité – or du dollar, le dévalue une première puis une seconde fois (l’once d’or passe successivement de 35 à 38 dollars, puis de 38 à 42), mais dans des proportions qui ne suffisent absolument pas à décourager les spéculations. Bretton Woods est à l’agonie.
Dans ce contexte, le deutschemark…
Il est important d’avoir à l’esprit, pour bien appréhender ce qui s’est passé à cette époque sur le plan monétaire, ce qu’était devenu le deutschemark.
Cela mérite un petit retour en arrière.
Nous sommes au début des années 20. Le Traité de Versailles frappe l’Allemagne de plein fouet : il est quasiment inapplicable. En vertu de son endettement et des conditions qui lui sont appliquées, l’Allemagne n’inspire confiance à personne : la spéculation bat son plein contre sa monnaie, le papiermark. Et le pays connaît l’un des épisodes d’hyperinflation les pires de toute l’histoire de l’économie.
En août 1923, un dollar s’échange contre 4,9 millions de marks (il s’échangeait contre 4,2 Marks en 1914).
Début octobre de la même année, il s’échange contre 440 millions de Marks.
Un mois plus tard, il s’échange contre 42 milliards de Marks.
C’est quasiment inimaginable. Au cours du mois d’octobre 1923, la valeur de la monnaie allemande dévissait à une telle vitesse qu’entre la commande d’un repas et le moment de payer l’addition, il fallait pratiquement servir un plat supplémentaire au client s’il n’avait pas réglé son repas avant de le prendre.
Or, c’est au mois de novembre 1923 qu’a lieu le fameux « putsch de la Brasserie » qui vaudra à Hitler d’être emprisonné, avant d’écrire Mein Kampf en détention. Cet épisode du putsch sera célébré tous les ans, comme la date anniversaire d’un événement fondateur, au cours du troisième Reich.
C’est dire combien, pour les Allemands, la question monétaire est importante. Ils auront retenu de ce traumatisme l’idée selon laquelle on ne doit pas laisser un pouvoir politique s’exercer sur la monnaie et courir le risque de l’inflation, car cela conduit au pire.
La monnaie allemande que nous connaissons, le deutschemark, est créée en 1948, en même temps que la Bundesbank, la Banque centrale allemande. Or, cette création monétaire et l’institution chargée d’en protéger la valeur ont rapidement doté le DM d’un capital confiance considérable qui ne s’est jamais démenti.
Retour, donc, à la tempête monétaire des années 70 : dans le contexte de taux d’inflation flirtant régulièrement avec des valeurs à deux chiffres, de l’apparition de plusieurs marchés de devises et même d’un éclatement du marché de l’or, le deutschemark allemand est resté une valeur refuge.
Il est important de l’avoir à l’esprit parce que c’est dès 1972, pour se protéger de l’unilatéralisme américain (Nixon avait notamment décidé d’une taxation de 10% des importations européennes, en suspendant la convertibilité – or du dollar en 1971), que sont posées les bases de ce qui deviendra l’euro : celles du « Serpent monétaire européen » (le SME). L’approche allemande, très stricte quant aux principes de lutte contre l’inflation et d’indépendance de toute Banque centrale, l’emportera sur l’approche française, à la veille de la création du marché unique et de la monnaie unique.
La sortie de crise par les accords de la Jamaïque : le nouvel ordre monétaire mondial
Du Sommet de Rambouillet
aux accords de la Jamaïque (ou de Kingston)
On peut penser qu’avec De Gaulle, les choses se seraient passées complètement différemment. Mais le référendum de 1969 a changé la donne.
En 1974, au moment de l’élection présidentielle, le différend monétaire franco-américain n’était toutefois pas réglé.
Mais dès 1975, Giscard d’Estaing entreprit d’innover en matière de sommets internationaux et inventa ce qui allait devenir les « G6 », « G8 » et autres « G20 » : il convoqua le Sommet de Rambouillet. Un concept très giscardien selon lequel les grands de ce monde se retrouvaient en bras-de-chemise au bord d’une piscine, pour régler directement entre eux les affaires en laissant sur le seuil fonctionnaires et conseillers. C’était en quelque sorte le premier « G » : en l’occurrence, un G5.
A l’occasion de ce sommet, la question monétaire fut réglée.
Un an plus tard, on signa les accords de la Jamaïque, à l’occasion desquels les statuts du FMI furent modifiés. Plus personne ne croyait aux taux de change « fixes mais ajustables » qui avaient eu la préférence française pendant les années précédentes. Les deux principales modifications qui furent entérinées portèrent sur la référence à l’or, tout bonnement supprimée, et l’instauration de taux de change flottants.
Ce qui est assez fascinant dans cette affaire, c’est l’apparente facilité, même si elle était adossée à une approche théorique qui avait le vent en poupe (celle de Milton Friedman, qui avait pris le contre-pied de Keynes : voir ci-après), avec laquelle tout le monde tomba d’accord sur ce parti-pris saisissant : il était admis que le dollar, auquel étaient arrimées les monnaies des États membres du FMI, n’était plus convertible en or… et plutôt que d’exiger une dévaluation du dollar (ce qui était le cas de De Gaulle, on s’en souvient), les partenaires des États-Unis acceptèrent tout simplement de se dire que, finalement, on passait la référence à l’or par pertes et profits.
En somme, les américains déclarèrent, dans la foulée de John Connally quelques années plus tôt : « cela vous gêne que nous ne puissions pas vous rembourser en or ? Eh bien on vous propose de se dire que, l’or, on s’en fout. » Et personne n’y trouva à redire.
Aparté théorique : l’approche keynésienne et l’approche monétariste
Il n’est pas inutile de se pencher sur les ressorts théoriques de ce qui s’est joué : il s’agit de principes de politique économique auxquels il est régulièrement fait référence dans le débat politique qui oppose, notamment, les formations qui se déclarent relever de la droite ou de la gauche.
En matière de politique économique, Keynes est un économiste auquel se réfèrent, en général, les partisans « de gauche » : il a théorisé l’opportunité de conduire des politiques dites « budgétaires » ou de relance par la demande dans certaines situations de crise. Or, dans le cadre de cette théorie, ce que Keynes a établi du rôle de la monnaie est central. Selon son approche, une plus ou moins grande quantité de monnaie mise en circulation a un impact sur l’économie réelle : en d’autres termes, selon qu’il est mis en circulation une plus ou moins grande quantité de monnaie, la quantité des échanges (achats – ventes de biens et de services) varie. Dit encore autrement, Keynes a établi que, dans certaines situations de crise, une injection de liquidités dans l’économie par la puissance publique (par exemple sous la forme de grands projets d’investissements publics) provoque une augmentation des échanges et permet, à terme, de relancer l’économie.
Des années après lui, Milton Friedman a pratiquement théorisé le contraire. Il a été le fondateur d’un courant de pensée : celui des « monétaristes. » Selon cette approche, une plus ou moins grande quantité de monnaie en circulation n’a pas d’impact sur la réalité des échanges (en tous cas pas durablement…) : elle n’a d’impact, en définitive, que sur le niveau général des prix. En d’autres termes, selon les monétaristes, une injection de liquidités qui augmente la quantité de monnaie mise en circulation finit inéluctablement par ne provoquer qu’une hausse des prix, donc de l’inflation. Et, toujours selon ce courant de pensée, il est donc primordial de confier le pouvoir de mettre de la monnaie en circulation à des organisations indépendantes du pouvoir politique, uniquement chargées de lutter contre l’inflation, laquelle érode la valeur des actifs.
C’est cette seconde approche qui l’a emporté, dans les années 70, lors de la signature des accords de la Jamaïque.
C’est à travers ce prisme que doit être interprété l’accord international qui a été établi autour de l’idée d’abandonner la référence à l’or. Reprenons là où nous étions : en substance, c’est comme si les américains avaient déclaré à leurs détracteurs et, plus particulièrement, aux français qui exigeaient qu’ils dévaluent le dollar en rétablissant les équilibres de leur budget de leur balance des paiements : « Supprimons la référence à l’or et instaurons un marché des devises parfaitement libre ; si vous avez raison, le dollar perdra automatiquement de la valeur par rapport aux autres monnaies. »
L’incidence des accords de la Jamaïque sur les politiques économiques des années 80
Une fois qu’il était établi la suppression de toute référence à l’or et l’instauration de taux de change flottants, ce qui s’est trouvé entériné dans les statuts du FMI, les principaux États membres du FMI décidèrent, en conformité avec les principes de cette modification statutaire, de libéraliser totalement les mouvements de capitaux à leurs frontières, de façon à créer le marché le plus libre jamais instauré.
C’est ainsi que, progressivement à partir de leur entrée en vigueur en 1978, les accords de la Jamaïque ont instauré une nouvelle ère, après celle du Change – Or : l’ère des taux de change flottants. Dans ce nouveau Système monétaire international, qui est celui dans lequel nous visons depuis, la richesse des États membres du FMI n’est plus indexée sur la valeur de l’or : elle n’est plus indexée sur aucune matière précieuse, ni sur aucun gage de quantité de quoi que ce soit, détenu où que ce soit. Elle est seulement établie sur le marché des devises, par le libre jeu de l’offre et de la demande.
Dans ce système, en bonne théorie économique, une monnaie est le fidèle reflet de la capacité d’une économie nationale à générer du revenu.
La première à prendre toute la mesure de ce nouveau système fut Margaret Thatcher. Dans son sillage, Ronald Reagan libéralisa lui aussi totalement les mouvements de capitaux aux frontières des Etats-Unis. Et, un peu partout en Europe, le même mouvement fut suivi au cours des années 80.
Pourquoi l’augmentation
des salaires n’est-elle plus indexée sur celle des gains de
productivité, comme pendant les 30 glorieuses ?
Pourquoi la
fiscalité du
capital est-elle avantageuse par rapport à celle du travail ?
Ce qui vient d’être rappelé permet d’apporter des réponses à
ces questions. L’adoption du nouveau Système monétaire
international en 1976 a fait de la lutte contre l’inflation une
priorité, et l’indexation des salaires sur les gains de
productivité provoque nécessairement de l’inflation. De plus, ce
nouveau système privilégie les mouvements de capitaux, qui
circulent plus librement que les biens et plus encore que les
personnes. Dans ce nouveau système, le premier qui réduit la
fiscalité sur la détention de capitaux les attire plus que les
autres, qui en ont besoin pour financer leurs investissements et leur
protection sociale : tous les pays sont plus ou moins contraints
de s’aligner sur le mieux disant, fiscalement parlant.
Le cas de la France est intéressant à examiner.
Lorsque François Mitterrand est élu Président de la République en 1981, le programme commun de la gauche est largement inspiré de l’approche keynésienne. Concrètement, le gouvernement de Pierre Mauroy applique les principes d’une relance par la demande : relèvement des minima sociaux, nationalisations, dévaluation.
A l’époque, Jacques Delors est Ministre de l’Economie, Laurent Fabius Ministre du Budget, Jacques Attali Secrétaire Général de l’Elysée où travaillent, comme conseillers, François Hollande et Ségolène Royal…
Et tout ce petit monde découvre que, dans un système d’économies ouvertes comme est celui des accords de la Jamaïque, le keynésianisme, cela ne marche pas – ou plus. La rentabilité des capitaux s’effondre sur le territoire national, la hausse de l’inflation est incontrôlée et il faut dévaluer la monnaie une deuxième puis une troisième fois. A moins d’être compétitive en termes de coût du travail, de fiscalité et / ou de règlementation, l’économie d’un pays d’où peuvent fuir les capitaux pour être placés là où l’on trouve les meilleurs rendements du capital investi a une valeur, que reflète sa monnaie, en diminution constante.
Et c’est donc « le virage de la rigueur » : un virage à, quasiment, 180° de ce qui était prévu dans le programme commun, consistant à adopter des principes de politique économique traditionnellement de droite : lutte contre l’inflation, rigueur budgétaire, ouverture du capital des entreprises publiques (Jospin est pratiquement le Premier Ministre qui a le plus privatisé sur la période 1981 – 2000).
La gauche française n’expliquera jamais ce qu’était ce virage : une conversion, et pas seulement une parenthèse. Pierre Bérégovoy le formulera, à sa manière : « les taux d’intérêt, je les monte quand je veux, je les baisse quand je peux. » C’est la politique dite « du franc fort » : le franc arrimé au deutschmark, la monnaie la plus stable et la plus forte sur l’ensemble du marché.
Toutes les gauches d’Europe de l’Ouest tireront les leçons de ce nouveau système monétaire, la troisième voie de Tony Blair et les réformes de Schröder étant les plus emblématiques.
Chaque Etat emprunte de quoi couvrir ses déficits sur des marchés internationaux à des créditeurs privés, dont la confiance qu’ils placent dans la solvabilité et le sérieux de leurs débiteurs est absolument centrale.
Résumons-nous :
Avec la modification des statuts du FMI en 1976, il a été mis fin à un système mondial qui avait permis la conduite de politiques keynésiennes de type budgétaire, comme en France avec un capitalisme d’Etat ayant considérablement investi dans des pans entiers de l’économie (les télécom, le transport, l’énergie, l’aérospatial…), les salaires étant indexés sur les gains de productivité ainsi obtenus, mais au prix de taux d’inflation élevés et erratiques.
On y a substitué un autre système qui ne permet plus de financer, par du déficit et de l’inflation, des investissements massifs et une politique salariale indexée sur les gains de productivité : un système qui a substitué, à l’inflation, l’endettement comme principal carburant.
De fait, il n’est que de jeter un coup d’œil sur les courbes d’endettement des États depuis le début des années 80 : ce sont des courbes de croissance exponentielle. Parallèlement, les taux d’inflation sont stabilisés à un faible niveau…
Dans ce nouveau système, théoriquement, les monnaies ne peuvent
plus faire l’objet d’une politique délibérée de compétitivité
– prix par dévaluation ou, à l’inverse, d’une politique de
captation de capitaux par renchérissement du coût de l’accès au
crédit provoquant une hausse de la rentabilité des prêts :
ces prérogatives sont celles des Banques centrales, des organismes
indépendants des .
Pourquoi la dette de
l’État, de même que celle des entreprises, de même que celle des
ménages, sont-elles constamment aggravées depuis des décennies ?
Ce qui vient d’être rappelé permet de répondre à cette
question : le nouveau SMI adopté en 1976 privilégie de la
façon la plus délibérée l’accès au crédit pour faciliter au
maximum les investissements, en s’efforçant de rendre totalement
libre et transparente la compétitivité des différentes économies
en matière de rentabilité des investissements.
Dans ce nouveau système, la lutte contre l’érosion de la valeur
de la richesse détenue est une priorité (c’est la lutte contre
l’inflation), tandis que l’endettement est conçu comme un
accélérateur de création de richesses.
Mais, par ailleurs, la dette de nombreux États augmente tout
simplement parce qu’y sont adoptés, année après année, des
budgets déficitaires…
Pourquoi les inégalités
de richesse détenue augmentent-elles partout dans le monde ?
C’est la question à laquelle il est le plus difficile de répondre.
Mais, schématiquement, on peut dire que ce nouveau système est
intrinsèquement favorable à l’accumulation de capital. En effet,
il privilégie l’enrichissement qui est d’autant plus important
que la richesse investie est elle-même importante.
Mais ce qu’il est important de souligner, c’est que l’essentiel
de cette richesse, qui correspond à des écritures de comptes bien
plus qu’à de la monnaie fiduciaire ou de la matière précieuse,
est largement constituée de reconnaissances de dettes et repose
principalement sur des mécanismes de recouvrement de crédit.
C’est donc une richesse qui peut disparaître purement et
simplement lorsque ce recouvrement fait défaut de façon systémique,
comme cela a été le cas en 2008…
Le cas particulier du dollar et la crise financière de 2008
Le fameux
« principal
taux d’intérêt directeur » de la Fed et ses variations
Tout cela n’est toutefois pas rigoureusement vrai de la même manière pour tout le monde.
Le dollar a longtemps gardé, jusqu’à ce qu’il soit partiellement détrôné par l’euro pour cela, un rôle privilégié : celui d’une référence mondiale permettant de chiffrer les plus importantes transactions internationales et, notamment, celles portant sur l’achat et la vente de pétrole.
De fait, les américains ont pu, depuis les années 80, creuser leurs déficits et leur endettement sans mettre en danger leur monnaie. Un coup d’œil sur les variations du principal taux directeur de la Fed permet de s’en rendre compte.
Le principal taux directeur de la Banque fédérale américaine, la Banque centrale fédérale des Etats-Unis, est le taux appliqué aux prêts interbancaires de liquidités de court terme. Ce taux est celui sur lequel sont indexés tous les autres : il donne le « la. »
Or, la Banque Fédérale américaine n’est pas seulement chargée de lutter contre l’inflation : elle doit aussi agir pour maximiser l’emploi. En d’autres termes, contrairement à la BCE dont l’action n’est pas censée tenir compte du taux de chômage des États membres, la Fed tient le plus grand compte de la politique économique conduite par la Maison Blanche et y adapte sa propre politique monétaire.
C’est ainsi que, si les Etats-Unis conduisent une politique d’investissements ou de dépenses massives, comme par exemple lors de « la guerre des étoiles » conduite sous Reagan, la Fed relève son principal taux directeur parce qu’elle interprète le fait qu’il va falloir attirer des capitaux pour financer cette politique.
En revanche, si les Etats-Unis conduisent une politique de rigueur budgétaire et de réduction de leurs déficits, la Fed abaisse son principal taux directeur pour faciliter les mouvements de capitaux interbancaires, promouvoir l’exportation en la rendant plus compétitive et fluidifier le financement de l’activité, qui pourrait être fragilisée par l’austérité de la politique conduite.
Reagan a donc, début des années 80, largement creusé le déficit budgétaire américain pour prendre de vitesse l’URSS dans la course aux investissements et dispositifs spatiaux. De fait, cette politique n’a pas pu être suivie par l’URSS et on peut même penser qu’elle n’est pas pour rien dans son effondrement. Or, début des années 80, le principal taux directeur de la Fed a été relevé de plusieurs points.
George Bush Junior, qui conduisit quasiment la même politique mais pour financer la seconde guerre du Golfe, déclarera quant à lui à peu près ceci : « Reagan a démontré que le déficit budgétaire, on s’en fout. »
Il est crucial de se pencher sur ce qui s’est passé, en effet, début des années 2000.
Ce qui a provoqué la crise financière de 2008
Au moment de « la nouvelle économie », comme on appelait alors le phénomène de création et de développement d’entreprises numériques (les fameuses « start-up ») début des années 2000, le principal taux directeur de la Fed était de 0,5 point.
Du point de vue de l’économie réelle, c’est d’ailleurs assez impressionnant : ce taux était inférieur, en réalité, au taux d’inflation. C’est-à-dire qu’en termes réels, lorsqu’un établissement prêtait beaucoup d’argent à un autre sur un très court terme (je te prête 10 milliards d’ici demain midi), c’est lui qui « rendait » de la valeur au débiteur au moment de recouvrer son prêt (quand tu me les rendras, c’est moi qui te devrai de l’argent).
Mais début des années 2000, il faut financer un effort de guerre.
Entre 2000 et 2005, le principal taux directeur de la Fed passe alors de 0,5 à plus de 6 points…
L’impact sur les taux appliqués à toutes les autres formes de prêt est considérable : la hausse des taux d’intérêt est généralisée.
Prenons le cas des emprunts de long terme à taux variable… les emprunts, par exemple, qui financent l’accès à la propriété immobilière… emprunts ayant fait l’objet d’une promotion tous azimuts aux États-Unis dans les années 2000, l’État fédéral encourageant l’accès à la propriété.
C’est ainsi qu’un grand nombre d’emprunteurs, éventuellement non ou peu solvables, imprudemment engagés sur des décennies avec des taux variables, ont vu leurs mensualités brutalement augmenter à cause de la hausse des taux déclenchée par le relèvement du principal taux directeur de la Fed.
Et les défauts de paiement surgirent en cascade.
Petite parenthèse au passage : Paul Jorion, un économiste (anthropologue, à la base…) travaillant au sein d’un établissement financier aux Etats-Unis juste avant l’éclatement de la crise, explique dans l’un de ses ouvrages le défaut de la modélisation mathématique appliquée au calcul des risques de ces contrats de prêt.
Lorsque vous prêtez de l’argent à un emprunteur dont la solvabilité est douteuse, le risque qu’il vous fait courir est tel que le taux d’intérêt que vous lui appliquez est élevé. Du même coup, la rentabilité de votre contrat est plutôt élevée, elle aussi.
Or, le mécanisme de « titrisation » qui a donné lieu aux fameuses « subprimes » a consisté à diluer ce risque, tout en maintenant le niveau de rentabilité. Schématiquement, ce mécanisme a consisté à créer, à partir de votre contrat de prêt, plusieurs produits financiers : vous revendez ainsi, en quelque sorte, vos contrats de prêts « par appartements. » A partir de plusieurs contrats de prêts que l’on appellera douteux, vous revendez ainsi trois lots de produits financiers : un lot qui garantit une rentabilité raisonnable, un lot présenté comme un peu plus risqué qui offre une meilleure rentabilité et un troisième lot présenté comme encore plus risqué qui offre la rentabilité la plus alléchante.
Ce qui vous permet de garantir la rentabilité du premier lot, c’est la dilution du risque de chaque contrat de prêt dans la création d’un produit financier qui repose sur un grand nombre de contrats. Si un emprunteur s’avère donc non solvable, la valeur perdue de son contrat sera absorbée par celle de tous les autres.
Mais ce que Jorion explique, c’est que le risque évalué de chacun des contrats de prêt ne tenait aucun compte d’une dimension systémique : celle d’un grand nombre de défauts de paiement en même temps. Dans des situations de crise systémique, que prennent en compte les assureurs, par exemple, le modèle mathématique appliqué au calcul du risque est différent de celui qui est appliqué aux risques individuels. Pour être couvert en cas de dégâts des eaux, vous réglez une certaine cotisation ; mais pour que l’assureur soit couvert en cas d’inondation de toute une région, c’est lui qui règle une autre cotisation à une compagnie de réassurance – voire à l’État.
Or, dans le cas des contrats de prêts de long terme à taux variable réservés à des emprunteurs peu solvables, le relèvement du principal taux directeur de la Fed a agi comme une inondation : il a provoqué un très grand nombre de défauts de paiement simultané. C’est cela, en réalité, qui a provoqué la crise financière de 2008, dont les « subprimes » ne sont que la partie émergeante et quelque peu sensationnelle.
C’est le cumul de cette sophistication à outrance de l’ingénierie financière avec l’impact du relèvement du principal taux de la Fed qui a déclenché cette crise historique.
La situation actuelle et l’enjeu de la relance du multilatéralisme
Le
« paradoxe de Triffin » et la question du gage de réserve
de valeur à l’échelle mondiale
Cette crise de 2008 a été suivie de l’adoption de nombreuses mesures pour se protéger d’une deuxième occurrence. Mais, de l’avis de nombreux observateurs, ces mesures n’ont rien changé sur le fond : nous sommes toujours dans le SMI de 1976, ayant conduit les États membres du FMI à libéraliser totalement les mouvements de capitaux à leurs frontières, et leur ôtant toute possibilité de conduire des politiques budgétaires, de relance par la demande, sauf à aggraver leur endettement et courir le risque d’un défaut de confiance dans leur solvabilité.
Au fond, la question qui est posée à l’international est celle de la fonction monétaire de réserve de valeur. Même si l’Euro est une monnaie qui a pris beaucoup d’importance dans les échanges internationaux, le dollar demeure le gage principal, à l’échelle mondiale, de réserve de valeur : un pays qui investit ou cherche à attirer des capitaux cherche toujours à protéger ses réserves en les libellant en dollars.
Robert Triffin, un économiste célèbre, a dénoncé en son temps le paradoxe qui résulte de cette situation :
-
Pour que le dollar constitue le gage principal de réserve de valeur à l’échelle mondiale, il faut que les États-Unis le diffusent largement et que leur balance des paiements soit déficitaire. En d’autres termes, il est nécessaire que les dollars « quittent » le sol étatsunien pour être « placés » comme réserves dans les pays qui en ont besoin.
-
Mais, ce faisant, le dollar devrait perdre de la valeur, précisément en raison du déficit de la balance des paiements américain : une plus grande quantité de monnaie mise en circulation se traduit toujours par une baisse de valeur de cette monnaie.
-
Or, une baisse de valeur du dollar devrait le rendre moins attractif et, à terme, cesser d’en faire le gage principal de valeur…
Ce phénomène de détente et de resserrement de la politique monétaire américaine est, du reste, à l’origine de la « tempête monétaire asiatique » de la fin des années 90. Les États-Unis ayant protégé la valeur du dollar dans les années 90 par une remontée des taux, la plupart des pays d’Asie qui avaient recours aux bons du Trésor américain pour « gager » leurs réserves n’avaient plus accès à suffisamment de monnaie américaine.
La Chine, surtout depuis qu’elle adhère à l’OMC, est sévèrement critique vis-à-vis de cette situation mondiale et propose de remplacer le dollar, en tant que réserve de valeur internationale, par un « panier de monnaies » (qui pourrait être obtenu grâce à l’extension de l’usage des Droits de tirage spéciaux, les DTS, émis par le FMI).
En tout état de cause, notre système monétaire international souffre de cette fragilité endémique : celle du recours massif à une monnaie nationale pour couvrir la fonction de réserve de valeur.
A une autre échelle, la zone euro souffre en quelque sorte du même défaut : l’euro est une monnaie unique donc commune, ce n’est donc pas une monnaie nationale, mais c’est un véritable prolongement du Deutschemark. Au sein de la zone euro, l’Allemagne est en excédent structurel et la périphérie de la zone en déficit structurel vis-à-vis de l’Allemagne. En bonne théorie monétaire, il faudrait donc procéder à un ajustement de valeur et dévaluer la monnaie là où se creusent les déficits et réévaluer la monnaie là où se concentrent les excédents.
Or, ce principe de solidarité financière (ces ajustements correspondraient en quelque sorte en un transfert de valeur ou, plus exactement, en une compensation de l’actuel transfert de valeur vers l’Allemagne), l’Allemagne ne veut pas en entendre parler.
Ce sera, de toute façon, une question de négociation internationale : aucun pays ne peut vraiment prendre de décision tout seul en la matière sauf, en raison du poids qu’ils pèsent sur l’économie mondiale, les États-Unis et la Chine – et encore.
Il est donc essentiel de relancer le multilatéralisme, à l’agonie depuis, précisément, la crise financière de 2008, même s’il était déjà fort mal en point en raison d’un cycle entamé à Doha en 2003 et qui, à l’époque, était censé durer trois ans. Mais c’est une autre histoire…


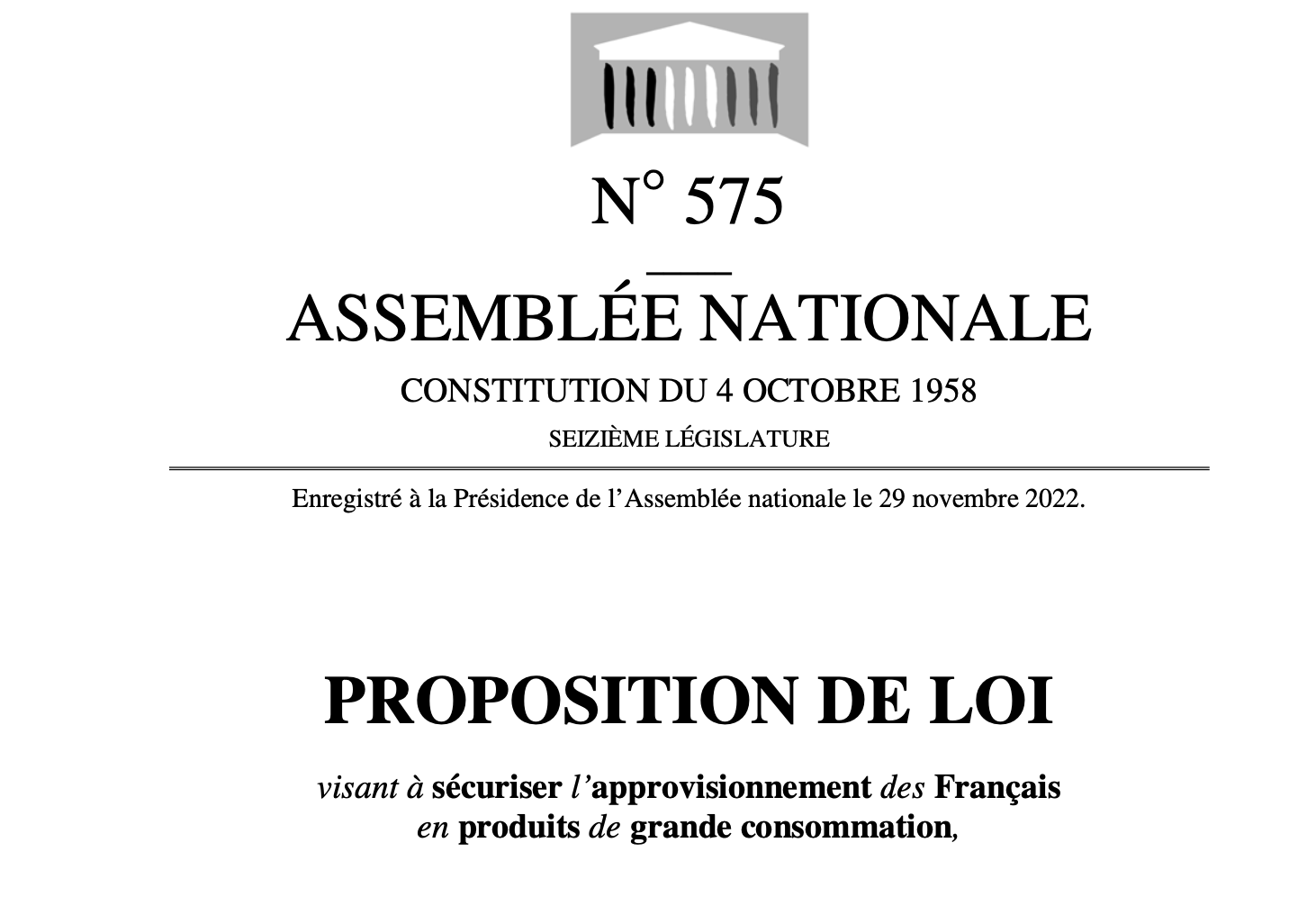
1 commentaire
- Frédéric Descrozaille · 1 mai 2019 à 16 h 31 min
[…] Or, c’est une question dont je crois qu’elle est mal connue et à laquelle les media n’accordent jamais le temps de l’aborder correctement. Par crainte, peut-être, d’ennuyer. J’en prends ici le risque, c’est le privilège de l’écrit. Cliquez ici pour lire le premier article […]