Cinéphile, je prendrais volontiers le temps d’écrire des avis critiques sur telle ou telle œuvre cinématographique, récente ou ancienne. Mais je ne publie sur ce blog que ce qui est relatif à l’exercice de mon mandat.
Si je choisis donc d’écrire quelque chose à propos de « Banlieusards », c’est parce que ce film m’a frappé par son acuité politique – entre autres… car il est remarquable de très nombreux points de vue.
Il dit quelque chose, avec talent, de l’époque que nous vivons. C’est un reflet, d’une stupéfiante clairvoyance, du moment politique si singulier que notre pays connaît depuis quelques années.
L’histoire est centrée sur les parcours croisés de trois frères. L’aîné vit d’activités illégales, c’est une sorte de caïd. Le second a misé sur les études et s’apprête à passer l’épreuve finale d’un concours d’éloquence. Le troisième est scolarisé, il grandit sous les influences complémentaires et contradictoires de deux grands frères qu’il aime et qu’il admire. Ils habitent tous les trois dans le même quartier, barres d’immeubles et parterres de béton typiques des banlieues appelées « cités. »
La photo est belle, la direction d’acteurs est impeccable, les seconds rôles sont époustouflants de vérité, le montage rend le récit lisible et rythmé, c’est sans mauvais goût, finement observé, captivant dès les premières images. On est pris et le film tient toutes ses promesses. En particulier celle d’une chute qui vient résoudre une tension allant crescendo, sans insistance ni complaisance.
Le concours d’éloquence, notamment, est jubilatoire. Et ce morceau de bravoure, teinté de poésie, percutant, soutenu, osé, est presque un court métrage à lui seul qui saisit, d’un geste ample et magistralement théâtral, l’ensemble du long métrage dont il est l’une des toutes dernières scènes à laquelle, de façon abstraite, on pourrait presque le réduire.
Kery James est un artiste, mais c’est aussi un intellectuel. Son film est réfléchi, éloquent, finement écrit. Mais grâce à son talent et, certainement, à celui de Leïla Sy qui l’a coréalisé avec lui, cette écriture profonde, sous forme de coup de gueule à la fois poétique et provocant, sous-tend une animation naturelle qui ne cède jamais à la lourdeur ni à l’emphase auto-complaisante.
Or, son propos aurait pu faire couler par le fond toute son entreprise. C’est un regard sur le monde, sur la société, à la fois dur et exigeant, subversif et généreux. La réussite réside, peut-être essentiellement, dans le fait qu’on en sort réjoui, enthousiaste, sans savoir quel est « le message » qu’il fallait retenir, au juste. Et on en parle, on se souvient, on revit les scènes, et on s’aperçoit qu’on a des choses à dire, que le film fait réfléchir, qu’il donne à penser.
La joute verbale qui oppose les deux finalistes du concours d’éloquence a ceci de brillant qu’elle sublime la contradiction qui les distingue. Chacune de leurs interventions s’impose avec l’autorité de l’évidence, de la justesse de sa formulation, dans une langue merveilleusement maîtrisée. Et pourtant, chacune de leurs interventions, imparable, vient contredire très exactement la précédente. Il en résulte une richesse qui bouscule, ébranle, surprend.
A ce stade, tout lecteur qui n’a pas vu le film devrait suspendre sa lecture et attendre, avant de poursuivre, de l’avoir vu, sous peine de savoir sur le film quelques précisions qu’il est infiniment préférable d’ignorer au moment de le découvrir.

Le concours d’éloquence qui vient presque clore le récit met en scène deux locuteurs dont l’un doit répondre par l’affirmative et l’autre, par la négative, à la question de savoir si l’État est responsable de la situation dans laquelle sont les banlieues.
La finaliste qui intervient pour incriminer la responsabilité de l’État dénonce la crise du politique. Crise de confiance, faillite des élites, refus et renoncements, hypocrisie, racisme refoulé et bonne conscience bon marché, disqualification de la démocratie : tout y passe. Nous sommes bien dans le réel. Celui de l’abstention, de la montée des extrêmes, du discrédit de la classe politique, de la contestation des autorités publiques. Et cela fait froid dans le dos.
Le finaliste qui la contredit dénonce, quant à lui, la crise de l’engagement… tendance victimaire, projection de toutes les frustrations et de toutes les déceptions, colère et ressentiment qui chassent pour les remplacer ambition et volonté, perte de foi dans l’avenir et en soi-même, renoncement, oubli de l’essentiel : le libre arbitre, inviolé, qui permet tout simplement de choisir. Choisir entre faire et subir, croire et douter, agir et attendre, se hisser ou se plaindre. Choisir, pour la société, pour son quartier, pour sa famille, « la solidarité ou le chacun pour soi. » Et c’est un enthousiasme.
Voilà tout ce que donne à voir le film. Trois vies, trois parcours ; deux que distinguent des choix opposés, un troisième encore à définir. Un environnement dur, décourageant, auquel sont opposées deux sortes d’ambitions : pour soi-même ou pour les autres vs pour soi-même et pour les autres.
Chacun est renvoyé à lui-même, au terme d’un récit éblouissant qui ne prétend pas donner de leçons ni même adresser un message, trop subtil pour être révélé sans nuance. Un récit qui met brillamment en scène des adhésions et des contradictions, des harmonies et des dissonances, de la violence et de la tendresse, de la bravoure et de la lâcheté, des convictions et des doutes.
Un film, c’est un divertissement. Nous sommes dans le septième art. Un film qui divertit, c’est un film qui atteint son but. Mais un film qui, plus qu’il ne divertit, donne à voir et à penser, c’est un film qui atteint plus que son but, qui va au-delà de lui-même.
Le regard de Kery James sur notre monde, sur notre société, est clairvoyant, pertinent et formidablement exigeant. Son énergie, son appétit de comprendre, sa combativité sont fabuleusement communicatifs.
Chapeau bas.


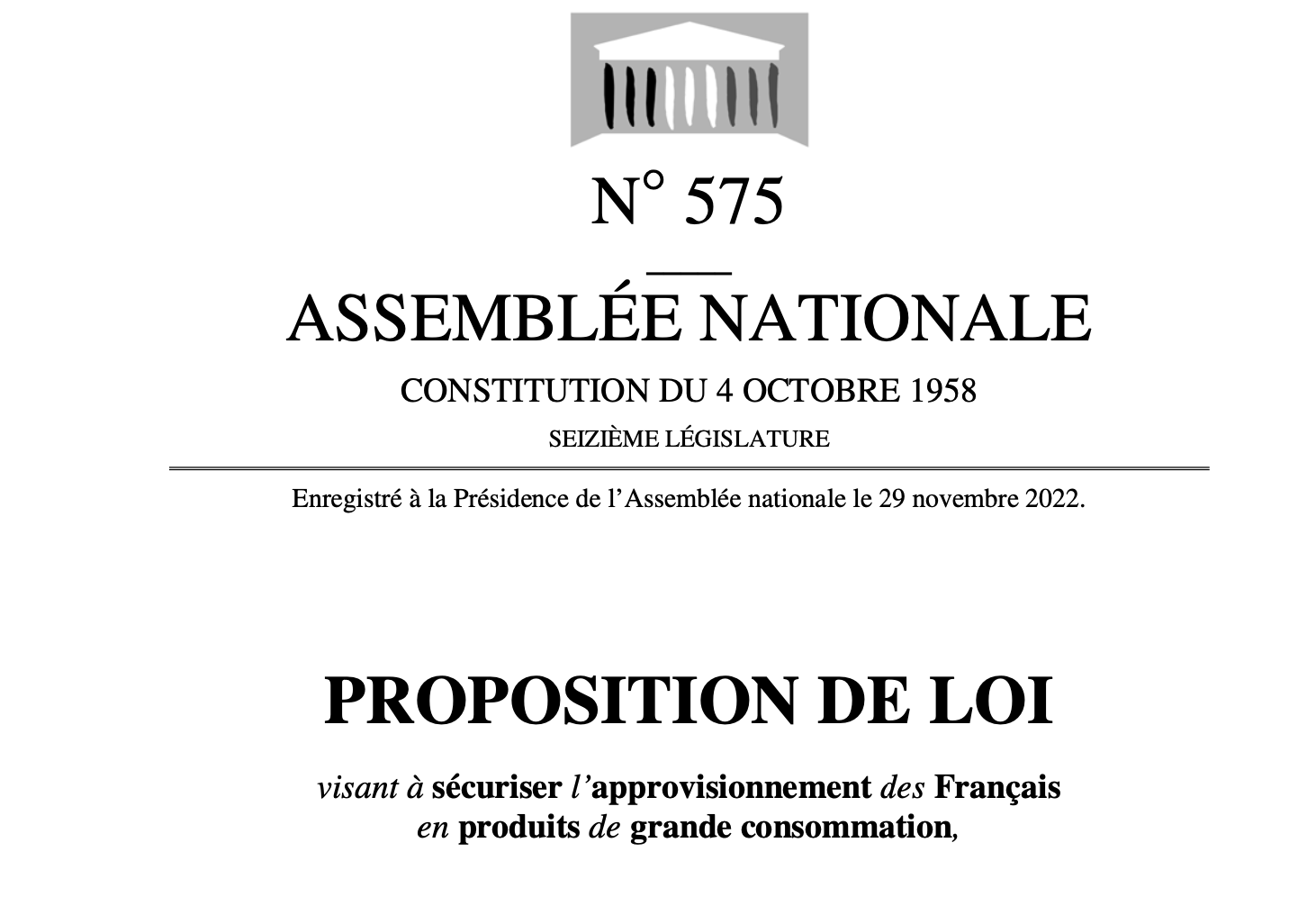
0 commentaire